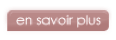Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
CHEMSEX, Trauma et EMDR - IMO.
L’Échelle de mesure «CROIRE EN MOI» Entre technique d’Exception-Différence-Relation (EDR modèle ACS) et séances d’EMDR-IMO (1), déroulé d’une thérapie en huit entretiens pour « guérir l’intime » d’un patient addict au chemsex et dont il faut « déboulonner » les traumas.
Le chemsex est une pratique sexuelle actuellement en plein essor dans le milieu des hommes ayant une sexualité avec des hommes (HsH). Cette pratique mêle une double addiction au sexe et aux nouvelles drogues de synthèse, généralement dans des contextes de partouzes (« plans »).
Nous voyons apparaître, au vu du plaisir dé* Ployé et de l’endurance obtenue lors de ces contextes, des addictions rapidement ancrées surtout en cas d’injection (« slam »).
Cette pratique devient un enjeu de santé publique même si l’utilisation de la Prophylaxie pré-exposition (PrEP) permettant une prévention des contaminations au VIH est usuelle. Une consultation gratuite et spécialisée chemsex m’est confiée au CSAPA (2) du centre Monceau.
Monsieur X., la trentaine, se présente à ma consultation chemsex, il pleure énormément en parlant de cette tristesse inconsolable, d’une envie de mourir et des traumatismes subis au cours de sa vie (abus sexuels par sa nounou sur plusieurs années lors de sa petite enfance, rejet parental dû à son homosexualité, agression physique par son ex avec qui il est tombé, il y a deux ans, dans le slam, pratique qui consiste à s’injecter des produits de synthèse).
Ayant traversé les océans pour rejoindre la France, passionné de littérature, il a fait des études de comptabilité afin de plaire à son père. Pourtant, il ne rêve que d’écrire et n’est venu ici que pour fuir le jugement et s’épanouir dans son identité HsH assumée. Dès son arrivée il y a trois ans, il trouve un travail en lien avec son diplôme, rencontre un homme dont il tombe fou amoureux et fait la connaissance du chemsex. Ils vont le pratiquer ensemble dès le début de leur relation avec de multiples partenaires. Et après une rupture douloureuse, il maintient cette habitude désormais hebdomadaire et indésirable.
Sur ce premier entretien, il est extrêmement agité, il parle de la déception qu’il a infligée à son père, homme très religieux et de ses phrases qu’il ne parvient pas à effacer : « Je ne peux accepter d’avoir un fils gay, tu peux oublier que tu as une famille... » Il se remémore également la prise de distance de sa mère et se sent coupable de tout cela.
Dès son arrivée , il trouve un travail en lien avec son diplôme, rencontre un homme dont il tombe fou amoureux et fait la connaissance du chemsex. Après évaluation, il ne présente pas de risque suicidaire et je lui évoque la technique de mouvements oculaires indéniablement utile en cas de psychotraumatisme. S’il décide de revenir, nous pourrons envisager ce traitement s’il en est désireux suite à la présentation de cette méthode. Le fait d’atteindre l’objectif formulé : « je veux croire en moi » permettra selon lui l’arrêt du chemsex qui est devenu désormais le danger à éviter. Croire en lui permettra aussi d’entamer des études de littérature et de « se sentir capable de vivre ».
Au travers du modèle Approche Centrée Solution (ACS) – mon socle de référence depuis de nombreuses années – il est pratiquement toujours possible dès le premier entretien de définir l’objectif des patients rencontrés (l’objectif étant affinable, modulable, réorientable), en commençant en parallèle à tenter une activation des ressources qui soit la plus efficace possible. Activation se devant d’être respectueuse du patient et de sa temporalité, afin qu’il puisse parvenir à dire un jour qu’il n’a plus besoin d’un travail thérapeutique. De plus, la dimension des exceptions au problème est centrale dans ce modèle et son exploration stratégique permet généralement des bénéfices rapides chez le patient.
Lors du deuxième entretien, nous regardons comment nous pouvons commencer à agir sur la consommation de chemsex de M. X. et explorons donc les moments où la consommation le laisse un peu plus tranquille (externalisation pour le sortir de cette identité de « chemsexeur »).
Nous trouvons notamment que l’emploi alimentaire qu’il occupe actuellement l’amène certaines fois à travailler le week-end, ce qui diminue la consommation. Nous convenons qu’il lui est possible (toujours demander l’autorisation du patient) de s’organiser pour travailler sur plus de week-ends, ce qui im* Pactera la fréquence des plans chemsex. Par le suivi que nous entamons, impliquant un regard extérieur, il a pu ne rester que seize heures sur le dernier plan à la place des deux jours habituels.
En observant ce qu’il a fait différemment sur les moments préservés, nous remarquons qu’il lit plus, qu’il a étudié certains textes, s’est fait à manger... M. X., toujours très fragile, aborde sa vie en observant des obligations qu’il se donne sans jamais s’autoriser à prendre du plaisir dans son quotidien. En explorant les bénéfices avec la technique d’Exception-Différence-Relation (EDR modèle ACS) nous obtenons un épaississement de ses compétences (neuroplasticité cérébrale permettant l’utilisation de nouveaux chemins neuronaux). Cela permet également de commencer à décaler le patient de l’intrication identitaire à la consommation. En fin d’entretien, nous convenons d’une tâche d’observation des moments où il parvient à ne pas consommer, à retarder ou abréger un plan. De plus, il accepte une tâche (paradoxale dans le sens de le contraindre au plaisir) qui l’amènera à réserver une heure par jour pour faire des activités lui faisant plaisir.
Nous ferons lors du troisième entretien, environ un mois après, un état des lieux concernant les points d’avancée malgré les difficultés, afin de solidifier et encourager ce qui existe déjà. Nous évaluons aussi les tâches afin de réaxer le travail thérapeutique. Nous pouvons déjà noter des ressources qui s’étoffent et permettent de commencer à mettre le patient sur la voie de l’espoir. M. X. met en avant qu’il réalise avoir fait un pas sur le fait d’être conscient, qu’il voit les points à changer et remarque que la tâche de prendre du plaisir lui a imposé quelque chose qu’il s’interdisait, qui pourtant lui fait du bien, le connecte à lui-même et lui permet d’accompagner la réduction de consommation.
Le chemsex est encore d’actualité mais a fortement diminué... Nous évaluons l’échelle que nous avions posée dès le premier entretien autour de « croire en moi ». Il évalue être à 4/10 sur l’échelle alors qu’il était à 0,5 au premier entretien. Il estime qu’une fois arrivé à 8 sur cette échelle, cela indiquera que notre travail est terminé. Nous en profitons pour épaissir les bénéfices déjà obtenus grâce à la technique EDR ci-dessus évoquée (qu’est-ce que cela change ? comment le remarquez-vous ? comment cela bouge vos pensées, émotions, actions ? qu’est-ce que cela permet qui n’était pas possible avant ?...) = Neuroplasticité cérébrale.
Nous affinons la préparation de la séance d’EMDR - IMO (en plus des notes prises avec son autorisation lors du premier entretien). J’explique le fonctionnement d’une séance, son protocole et préviens des effets secondaires possibles (fatigue, nausée, vomissement, diarrhée, pleurs, colère...). J’insiste sur le fait que cette séance risque d’être extrêmement remuante pour lui, au vu de l’ancienneté et de la place du trauma dans sa structuration psychique. Elle est prévue d’un commun accord au prochain entretien.
Le jour de la séance, ou quatrième entretien. A partir de mes notes, en l’invitant à suivre les mouvements avec ses yeux sans bouger la tête, je lui pose entre chaque mouvement la même question : « qu’est-ce qui vient ? ». En lui ayant précisé auparavant que cela peut être une pensée, une émotion, une sensation, une image, une phrase, un souvenir, un ressenti corporel... Et que nous prenons ce qui vient spontanément.
A l’inverse de mon modèle Socle Orienté Solution, le mouvement oculaire vient entrer dans la douleur traumatique afin de la cibler proprement, la nettoyer et l’aider à cicatriser. Je reprendrai les phrases de mon patient sans modification aucune et l’inviterai pour chacune à pouvoir les répéter dans sa langue maternelle (ce que je fais avec chaque patient qui n’a pas eu comme première langue le français car cela me semble plus propice à « déboulonner » le trauma). Ces phrases formulées telles que son père a pu lui exprimer ou de la manière dont il se dit les choses intérieurement sont notées précisément sans que j’y introduise le moindre changement.
La séance va demander une présence analogique et un étayage forts, tout en veillant à être à la bonne distance, notamment par des mots de soutien (Digital) accompagnés d’un regard bienveillant (Analogique) face à l’émotionnel blessé de mon patient qui prendra une dimension explosive au cours de la séance. Nous utiliserons ci-dessous « MO » pour indiquer chaque fois que nous effectuons des mouvements oculaires.
Je m’assois comme toujours en décalé face à mon patient afin de pouvoir faire les mouvements et prendre des notes sur mon carnet. Nous testons la distance par rapport à ses yeux. Certaines phrases sont répétées plusieurs fois à la suite lors du mouvement.
- Thérapeute : MO + « Mes parents n’acceptaient pas que je sois homosexuel, ils n’ont que la religion dans la tête.
- Patient : Je déteste mon père.
- Th. : MO + « Il me regarde comme un possédé (rebondir avec une phrase récoltée lors de la préparation de la séance).
- P. : Ils ne sont jamais contents de moi, comme si j’étais perdu (M. X. s’agite, il bouge sur son fauteuil).
- Th. : C’est comment dans le corps ?
- P. : Je me sens coincé.
- Th. : Respirez ! Les mains, les pieds, des sensations particulières ? (les patients y ressentent souvent des picotements ou autres sensations lorsque l’on cible bien le trauma).
- P. : Lourd et chaud.
- Th. : OK, on reprend. MO + « Tu peux oublier que tu as une mère...
- P. : Elle a pris ses distances avec moi, je souffre ! (M. X. se met à pleurer).
- Th. : MO + « Je ne peux accepter d’avoir un fils gay, tu peux oublier que tu as une famille...
- P. : Mon père m’a traité de pédé et de fauxcul, je n’oublierai jamais son regard... (M. X. bouge énormément, il pleure et se mouche beaucoup).
- Th. : Je sais que c’est très difficile pour vous de repasser par ces moments, courage, on continue... MO + « Tu es égoïste, tu ne penses qu’à toi...
- P. : Je n’ai pas de famille, je n’aurai jamais de famille (il s’effondre, crie dans sa langue maternelle des insultes adressées à son père).
- Th. : Voulez-vous que je me retourne ? (analogique afin de ne pas lui imposer mon regard).
- P. : Je ne supporte pas qu’on me regarde dans cet état ! (dit-il agressivement, me criant dessus au milieu des larmes et de la morve coulant sur son visage).
Je me retourne en lui demandant s’il veut un verre d’eau.
- P. : Je veux arrêter et partir.
Il se lève dans une agitation qu’il ne peut contrôler, le visage décomposé, en criant des insultes dans sa langue maternelle.
- Th. : Désolée, comme je vous l’avais dit, nous devons continuer afin de traiter le psychotrauma ; maintenant que nous avons ouvert la brèche, il ne serait pas raisonnable de vous laisser partir comme cela. Accrochez-vous... (le soutien doit être infaillible à cet instant afin d’étayer le patient).
- P. : Je me laisse violer, je ne sais pas ce qu’est d’être un enfant “grâce” à cette baby-sitter !
Il se rassoit en acceptant de continuer.
- Th. : Oui, ce que vous avez vécu est totalement injuste... (acceptation de cette réalité traumatique). Courage, nous nous y remettons... MO + « Ils ne sont jamais contents de moi, c’est comme si j’étais perdu.
- P. : Je ne vis que pour les autres, je veux arrêter. Je veux accepter que ce que j’aime et pas pour faire plaisir aux autres... »
La séance durera 45 minutes, M. X. est épuisé et démoralisé, d’où l’importance de prévenir en amont les patients de l’après-séance, des conséquences possiblement difficiles sur plusieurs jours, de pouvoir prévoir quelqu’un de ressource et de l’importance d’aller se reposer après. De nombreux patients chemsexeurs m’ont signalé une sensation identique à une prise de kétamine à la sortie d’une séance d’EMDR-IMO. (Certains ont même pu dire avec humour : « merci pour la défonce gratos ! ».) Mon action en mouvements oculaires étant généralement extrêmement ciblée, elle ne nécessite normalement qu’une séance, sauf en cas de polytraumatismes ou pour certains traumas complexes fortement enracinés. L’utilisation de l’ACS en support permet la mise en place d’un socle thérapeutique solide et fructueux.
Un mois après, lors du cinquième entretien, nous évaluons l’effet du mouvement oculaire sur la problématique du patient, M. X. se dira avoir été extrêmement étonné de ses réactions lors de la séance. Il me présente ses excuses, étant désolé de m’avoir crié dessus, je lui dis qu’il est normal que les choses puissent sortir sous cette forme face à de grandes injustices et qu’il m’arrive régulièrement d’être face à d’intenses réactions de mes patients. Il m’avouera qu’en attendant avant la séance, fort perplexe, il se disait : « je vais faire son truc avec les yeux, ça a l’air de lui faire plaisir... franchement, je n’y croyais pas à ta technique » (je vouvoie M. X. qui oscille entre le vouvoiement et le tutoiement, ce qui est totalement OK pour moi).
Le mouvement oculaire vient entrer dans la douleur traumatique afin de la cibler proprement, la nettoyer et l’aider à cicatriser Et force est de constater qu’il va vraiment mieux, il met en avant qu’il présente beaucoup moins d’anxiété et que de nombreuses fois, il n’a pas eu envie de prendre des chems. Depuis notre dernier rendez-vous, il n’a fait qu’un seul plan qui a duré moins longtemps, il y a pris beaucoup moins de subs tances et même sous leur effet, il était plus en conscience. Il remarque que depuis le début de la thérapie, les fois où il en a pris, il gère de mieux en mieux et arrive même à dire non. Il sent qu’il se rapproche du bout du tunnel et qu’il a plus de force. « Je commence vraiment à m’en sortir. » Il évoque la question de se faire plaisir, il est radicalement sorti de la culpabilité qui y était associée, il arrive même aujourd’hui à se masturber sans se sentir coupable.
Ces avancées l’amènent ce jour à réévaluer son objectif d’arrêt du chemsex, il se pose la question d’aller sur une consommation régulée et décidée à l’avance (toujours accompagner le patient dans son objectif en lui soulignant dans ce cas le danger que cela peut représenter). Nous recoupons ce désir avec l’objectif thérapeutique posé lors du premier entretien : « croire en moi ». En réutilisant l’échelle, nous sommes à 6, et en explorant ce qui nous permettra d’aller vers le 8 désiré afin de finir la thérapie. Il est évident pour mon patient que nous devons nous pencher sur la relation « toxique » qu’il a pu avoir avec son ex, la séparation violente entraînant une consommation non plus sur le mode du plaisir mais sur celui de la fuite afin d’oublier. Nous préparons donc les prochains mouvements oculaires en récoltant ses douleurs autour de la violence de cette relation et de tout ce que cela impliquait.
Au sixième entretien, nous faisons une séance d’EMDR-IMO essentiellement basée sur le vécu de la violence de l’abandon. Le patient est agité mais moins que lors de la première séance, anticipant sûrement mieux les implications de ce travail. La notion de culpabilité d’avoir accepté l’inacceptable émergera au cours de la séance. A la fin de la séance, et une fois l’orage passé, je lui donne à nouveau des instructions d’évaluation des bénéfices. Bénéfices sur la question de la consommation de chemsex et sur la mesure de l’échelle « croire en moi ». Nous prévoyons de nous revoir comme à l’habitude environ un mois après.
À la séance suivante et septième entretien, M. X. met fièrement en avant qu’il n’a pas consommé depuis deux mois et demi. Nous pouvons donc évaluer que le rapport que mon patient entretient au chemsex a radicalement changé, notamment de par le traitement traumatique. En effet, l’abus sexuel et la réaction de ses parents en apprenant son homosexualité (sans jamais avoir eu connaissance de l’abus) avait, comme souvent, amené la découverte du chemsex comme une solution afin de désintriquer le trauma de la dynamique sexuelle, permettant au consommateur de découvrir un espace de plaisir totalement préservé.
La deuxième séance de mouvements oculaires, en touchant le point d’entrée dans une consommation à vocation d’oubli de la douleur amoureuse, a permis de recentrer le patient sur ses besoins et priorités. M. X. va mieux, tellement mieux, il dit : « maintenant je fais attention aux arbres, aux fleurs, au soleil et au jour bleu... ».
Nous nous concentrons sur la mesure des changements et les ancrons par le questionnement EDR (qu’est-ce qui va mieux ? qu’est-ce que cela change ? qu’est-ce que cela permet qui n’était pas possible avant ? comment s’en rend-il compte ? comment les autres pourraient le percevoir ? qu’est-ce que cela dit de lui-même ? pourquoi ? comment ? quoi d’autre ? et quoi encore ?... avec un balayage sur les émotions, les pensées et les actions).
Ce tissage permet un travail intégratif des bénéfices et leur ancrage en profondeur. Il pourra dire à quel point cela a bougé son niveau d’exigence envers lui-même, en acceptant de prendre du plaisir dans la vie. Il m’avouera qu’il était choqué, bien qu’il ait accepté cette tâche donnée au deuxième entretien, par le fait d’avoir le droit de prendre du plaisir. Le fait d’introduire la dimension du plaisir qu’il s’interdisait, en s’appuyant sur son niveau d’exigence, a permis de reconfigurer son rapport à ces deux points.
Il parle d’une renaissance en arrêtant de penser de manière incessante au passé et envisage même de reprendre des études de littérature. La mesure de l’échelle nous amène à un joli 8,5 qui lui permet de croire en lui et d’être son meilleur allié. La thérapie a bien atteint son objectif selon lui. Nous prévoyons une dernière séance dans deux mois afin de finaliser en sécurité toutes ses avancées.
Sur ce dernier et huitième entretien, M. X. n’a toujours pas refait de chemsex. Il a compris que le moteur de ses consommations était la honte et la culpabilité (sentiments souvent présents dans les traumas sexuels). Il évoque un mouvement intérieur profond, une guérison qu’il n’avait jamais pensé possible ni envisageable. Non seulement aujourd’hui il s’accepte mais se trouve enfin beau, me disant : « tu as guéri mon intime ». Le dernier entretien offre au thérapeute cette image magnifique de l’alignement de la personne ; l’alignement de ses actions sur ses intentions et ses valeurs, ainsi que celui de ses pensées, ses émotions et ses actions. Nous mesurons et ancrons avec les outils de l’ACS afin de le laisser reprendre plus légèrement le cours de sa vie, parvenant désormais à croire en lui.
NOTES
1. ACS : Approche Centrée Solution ;
EMDR :Eye Movement Desensitization and Reprocessing ;
IMO : Intégration par les Mouvements Oculaires.
EMDR - IMO: (appelée aussi EMDR Intégrative) développée par Laurent GROSS dans les années 2007
2. CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie pour la Prise en Charge
SOPHIE TOURNOUËR Psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de couple. Hypnothérapeute, spécialisation en psychotraumatisme.
Formatrice et superviseur au CHTIP COLLÈGE D’HYPNOSE ET THÉRAPIES INTÉGRATIVES DE PARIS, à l’Institut INDOLORE, à l’Institut HYPNOTIM.. Elle est Membre de France EMDR IMO.
Elle est formatrice entre autre sur l'Approche Centrée Solution dans le cadre du CHEMSEX.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
Nous voyons apparaître, au vu du plaisir dé* Ployé et de l’endurance obtenue lors de ces contextes, des addictions rapidement ancrées surtout en cas d’injection (« slam »).
Cette pratique devient un enjeu de santé publique même si l’utilisation de la Prophylaxie pré-exposition (PrEP) permettant une prévention des contaminations au VIH est usuelle. Une consultation gratuite et spécialisée chemsex m’est confiée au CSAPA (2) du centre Monceau.
Monsieur X., la trentaine, se présente à ma consultation chemsex, il pleure énormément en parlant de cette tristesse inconsolable, d’une envie de mourir et des traumatismes subis au cours de sa vie (abus sexuels par sa nounou sur plusieurs années lors de sa petite enfance, rejet parental dû à son homosexualité, agression physique par son ex avec qui il est tombé, il y a deux ans, dans le slam, pratique qui consiste à s’injecter des produits de synthèse).
Ayant traversé les océans pour rejoindre la France, passionné de littérature, il a fait des études de comptabilité afin de plaire à son père. Pourtant, il ne rêve que d’écrire et n’est venu ici que pour fuir le jugement et s’épanouir dans son identité HsH assumée. Dès son arrivée il y a trois ans, il trouve un travail en lien avec son diplôme, rencontre un homme dont il tombe fou amoureux et fait la connaissance du chemsex. Ils vont le pratiquer ensemble dès le début de leur relation avec de multiples partenaires. Et après une rupture douloureuse, il maintient cette habitude désormais hebdomadaire et indésirable.
Sur ce premier entretien, il est extrêmement agité, il parle de la déception qu’il a infligée à son père, homme très religieux et de ses phrases qu’il ne parvient pas à effacer : « Je ne peux accepter d’avoir un fils gay, tu peux oublier que tu as une famille... » Il se remémore également la prise de distance de sa mère et se sent coupable de tout cela.
Dès son arrivée , il trouve un travail en lien avec son diplôme, rencontre un homme dont il tombe fou amoureux et fait la connaissance du chemsex. Après évaluation, il ne présente pas de risque suicidaire et je lui évoque la technique de mouvements oculaires indéniablement utile en cas de psychotraumatisme. S’il décide de revenir, nous pourrons envisager ce traitement s’il en est désireux suite à la présentation de cette méthode. Le fait d’atteindre l’objectif formulé : « je veux croire en moi » permettra selon lui l’arrêt du chemsex qui est devenu désormais le danger à éviter. Croire en lui permettra aussi d’entamer des études de littérature et de « se sentir capable de vivre ».
Au travers du modèle Approche Centrée Solution (ACS) – mon socle de référence depuis de nombreuses années – il est pratiquement toujours possible dès le premier entretien de définir l’objectif des patients rencontrés (l’objectif étant affinable, modulable, réorientable), en commençant en parallèle à tenter une activation des ressources qui soit la plus efficace possible. Activation se devant d’être respectueuse du patient et de sa temporalité, afin qu’il puisse parvenir à dire un jour qu’il n’a plus besoin d’un travail thérapeutique. De plus, la dimension des exceptions au problème est centrale dans ce modèle et son exploration stratégique permet généralement des bénéfices rapides chez le patient.
Lors du deuxième entretien, nous regardons comment nous pouvons commencer à agir sur la consommation de chemsex de M. X. et explorons donc les moments où la consommation le laisse un peu plus tranquille (externalisation pour le sortir de cette identité de « chemsexeur »).
Nous trouvons notamment que l’emploi alimentaire qu’il occupe actuellement l’amène certaines fois à travailler le week-end, ce qui diminue la consommation. Nous convenons qu’il lui est possible (toujours demander l’autorisation du patient) de s’organiser pour travailler sur plus de week-ends, ce qui im* Pactera la fréquence des plans chemsex. Par le suivi que nous entamons, impliquant un regard extérieur, il a pu ne rester que seize heures sur le dernier plan à la place des deux jours habituels.
En observant ce qu’il a fait différemment sur les moments préservés, nous remarquons qu’il lit plus, qu’il a étudié certains textes, s’est fait à manger... M. X., toujours très fragile, aborde sa vie en observant des obligations qu’il se donne sans jamais s’autoriser à prendre du plaisir dans son quotidien. En explorant les bénéfices avec la technique d’Exception-Différence-Relation (EDR modèle ACS) nous obtenons un épaississement de ses compétences (neuroplasticité cérébrale permettant l’utilisation de nouveaux chemins neuronaux). Cela permet également de commencer à décaler le patient de l’intrication identitaire à la consommation. En fin d’entretien, nous convenons d’une tâche d’observation des moments où il parvient à ne pas consommer, à retarder ou abréger un plan. De plus, il accepte une tâche (paradoxale dans le sens de le contraindre au plaisir) qui l’amènera à réserver une heure par jour pour faire des activités lui faisant plaisir.
Nous ferons lors du troisième entretien, environ un mois après, un état des lieux concernant les points d’avancée malgré les difficultés, afin de solidifier et encourager ce qui existe déjà. Nous évaluons aussi les tâches afin de réaxer le travail thérapeutique. Nous pouvons déjà noter des ressources qui s’étoffent et permettent de commencer à mettre le patient sur la voie de l’espoir. M. X. met en avant qu’il réalise avoir fait un pas sur le fait d’être conscient, qu’il voit les points à changer et remarque que la tâche de prendre du plaisir lui a imposé quelque chose qu’il s’interdisait, qui pourtant lui fait du bien, le connecte à lui-même et lui permet d’accompagner la réduction de consommation.
Le chemsex est encore d’actualité mais a fortement diminué... Nous évaluons l’échelle que nous avions posée dès le premier entretien autour de « croire en moi ». Il évalue être à 4/10 sur l’échelle alors qu’il était à 0,5 au premier entretien. Il estime qu’une fois arrivé à 8 sur cette échelle, cela indiquera que notre travail est terminé. Nous en profitons pour épaissir les bénéfices déjà obtenus grâce à la technique EDR ci-dessus évoquée (qu’est-ce que cela change ? comment le remarquez-vous ? comment cela bouge vos pensées, émotions, actions ? qu’est-ce que cela permet qui n’était pas possible avant ?...) = Neuroplasticité cérébrale.
Nous affinons la préparation de la séance d’EMDR - IMO (en plus des notes prises avec son autorisation lors du premier entretien). J’explique le fonctionnement d’une séance, son protocole et préviens des effets secondaires possibles (fatigue, nausée, vomissement, diarrhée, pleurs, colère...). J’insiste sur le fait que cette séance risque d’être extrêmement remuante pour lui, au vu de l’ancienneté et de la place du trauma dans sa structuration psychique. Elle est prévue d’un commun accord au prochain entretien.
Le jour de la séance, ou quatrième entretien. A partir de mes notes, en l’invitant à suivre les mouvements avec ses yeux sans bouger la tête, je lui pose entre chaque mouvement la même question : « qu’est-ce qui vient ? ». En lui ayant précisé auparavant que cela peut être une pensée, une émotion, une sensation, une image, une phrase, un souvenir, un ressenti corporel... Et que nous prenons ce qui vient spontanément.
A l’inverse de mon modèle Socle Orienté Solution, le mouvement oculaire vient entrer dans la douleur traumatique afin de la cibler proprement, la nettoyer et l’aider à cicatriser. Je reprendrai les phrases de mon patient sans modification aucune et l’inviterai pour chacune à pouvoir les répéter dans sa langue maternelle (ce que je fais avec chaque patient qui n’a pas eu comme première langue le français car cela me semble plus propice à « déboulonner » le trauma). Ces phrases formulées telles que son père a pu lui exprimer ou de la manière dont il se dit les choses intérieurement sont notées précisément sans que j’y introduise le moindre changement.
La séance va demander une présence analogique et un étayage forts, tout en veillant à être à la bonne distance, notamment par des mots de soutien (Digital) accompagnés d’un regard bienveillant (Analogique) face à l’émotionnel blessé de mon patient qui prendra une dimension explosive au cours de la séance. Nous utiliserons ci-dessous « MO » pour indiquer chaque fois que nous effectuons des mouvements oculaires.
Je m’assois comme toujours en décalé face à mon patient afin de pouvoir faire les mouvements et prendre des notes sur mon carnet. Nous testons la distance par rapport à ses yeux. Certaines phrases sont répétées plusieurs fois à la suite lors du mouvement.
- Thérapeute : MO + « Mes parents n’acceptaient pas que je sois homosexuel, ils n’ont que la religion dans la tête.
- Patient : Je déteste mon père.
- Th. : MO + « Il me regarde comme un possédé (rebondir avec une phrase récoltée lors de la préparation de la séance).
- P. : Ils ne sont jamais contents de moi, comme si j’étais perdu (M. X. s’agite, il bouge sur son fauteuil).
- Th. : C’est comment dans le corps ?
- P. : Je me sens coincé.
- Th. : Respirez ! Les mains, les pieds, des sensations particulières ? (les patients y ressentent souvent des picotements ou autres sensations lorsque l’on cible bien le trauma).
- P. : Lourd et chaud.
- Th. : OK, on reprend. MO + « Tu peux oublier que tu as une mère...
- P. : Elle a pris ses distances avec moi, je souffre ! (M. X. se met à pleurer).
- Th. : MO + « Je ne peux accepter d’avoir un fils gay, tu peux oublier que tu as une famille...
- P. : Mon père m’a traité de pédé et de fauxcul, je n’oublierai jamais son regard... (M. X. bouge énormément, il pleure et se mouche beaucoup).
- Th. : Je sais que c’est très difficile pour vous de repasser par ces moments, courage, on continue... MO + « Tu es égoïste, tu ne penses qu’à toi...
- P. : Je n’ai pas de famille, je n’aurai jamais de famille (il s’effondre, crie dans sa langue maternelle des insultes adressées à son père).
- Th. : Voulez-vous que je me retourne ? (analogique afin de ne pas lui imposer mon regard).
- P. : Je ne supporte pas qu’on me regarde dans cet état ! (dit-il agressivement, me criant dessus au milieu des larmes et de la morve coulant sur son visage).
Je me retourne en lui demandant s’il veut un verre d’eau.
- P. : Je veux arrêter et partir.
Il se lève dans une agitation qu’il ne peut contrôler, le visage décomposé, en criant des insultes dans sa langue maternelle.
- Th. : Désolée, comme je vous l’avais dit, nous devons continuer afin de traiter le psychotrauma ; maintenant que nous avons ouvert la brèche, il ne serait pas raisonnable de vous laisser partir comme cela. Accrochez-vous... (le soutien doit être infaillible à cet instant afin d’étayer le patient).
- P. : Je me laisse violer, je ne sais pas ce qu’est d’être un enfant “grâce” à cette baby-sitter !
Il se rassoit en acceptant de continuer.
- Th. : Oui, ce que vous avez vécu est totalement injuste... (acceptation de cette réalité traumatique). Courage, nous nous y remettons... MO + « Ils ne sont jamais contents de moi, c’est comme si j’étais perdu.
- P. : Je ne vis que pour les autres, je veux arrêter. Je veux accepter que ce que j’aime et pas pour faire plaisir aux autres... »
La séance durera 45 minutes, M. X. est épuisé et démoralisé, d’où l’importance de prévenir en amont les patients de l’après-séance, des conséquences possiblement difficiles sur plusieurs jours, de pouvoir prévoir quelqu’un de ressource et de l’importance d’aller se reposer après. De nombreux patients chemsexeurs m’ont signalé une sensation identique à une prise de kétamine à la sortie d’une séance d’EMDR-IMO. (Certains ont même pu dire avec humour : « merci pour la défonce gratos ! ».) Mon action en mouvements oculaires étant généralement extrêmement ciblée, elle ne nécessite normalement qu’une séance, sauf en cas de polytraumatismes ou pour certains traumas complexes fortement enracinés. L’utilisation de l’ACS en support permet la mise en place d’un socle thérapeutique solide et fructueux.
Un mois après, lors du cinquième entretien, nous évaluons l’effet du mouvement oculaire sur la problématique du patient, M. X. se dira avoir été extrêmement étonné de ses réactions lors de la séance. Il me présente ses excuses, étant désolé de m’avoir crié dessus, je lui dis qu’il est normal que les choses puissent sortir sous cette forme face à de grandes injustices et qu’il m’arrive régulièrement d’être face à d’intenses réactions de mes patients. Il m’avouera qu’en attendant avant la séance, fort perplexe, il se disait : « je vais faire son truc avec les yeux, ça a l’air de lui faire plaisir... franchement, je n’y croyais pas à ta technique » (je vouvoie M. X. qui oscille entre le vouvoiement et le tutoiement, ce qui est totalement OK pour moi).
Le mouvement oculaire vient entrer dans la douleur traumatique afin de la cibler proprement, la nettoyer et l’aider à cicatriser Et force est de constater qu’il va vraiment mieux, il met en avant qu’il présente beaucoup moins d’anxiété et que de nombreuses fois, il n’a pas eu envie de prendre des chems. Depuis notre dernier rendez-vous, il n’a fait qu’un seul plan qui a duré moins longtemps, il y a pris beaucoup moins de subs tances et même sous leur effet, il était plus en conscience. Il remarque que depuis le début de la thérapie, les fois où il en a pris, il gère de mieux en mieux et arrive même à dire non. Il sent qu’il se rapproche du bout du tunnel et qu’il a plus de force. « Je commence vraiment à m’en sortir. » Il évoque la question de se faire plaisir, il est radicalement sorti de la culpabilité qui y était associée, il arrive même aujourd’hui à se masturber sans se sentir coupable.
Ces avancées l’amènent ce jour à réévaluer son objectif d’arrêt du chemsex, il se pose la question d’aller sur une consommation régulée et décidée à l’avance (toujours accompagner le patient dans son objectif en lui soulignant dans ce cas le danger que cela peut représenter). Nous recoupons ce désir avec l’objectif thérapeutique posé lors du premier entretien : « croire en moi ». En réutilisant l’échelle, nous sommes à 6, et en explorant ce qui nous permettra d’aller vers le 8 désiré afin de finir la thérapie. Il est évident pour mon patient que nous devons nous pencher sur la relation « toxique » qu’il a pu avoir avec son ex, la séparation violente entraînant une consommation non plus sur le mode du plaisir mais sur celui de la fuite afin d’oublier. Nous préparons donc les prochains mouvements oculaires en récoltant ses douleurs autour de la violence de cette relation et de tout ce que cela impliquait.
Au sixième entretien, nous faisons une séance d’EMDR-IMO essentiellement basée sur le vécu de la violence de l’abandon. Le patient est agité mais moins que lors de la première séance, anticipant sûrement mieux les implications de ce travail. La notion de culpabilité d’avoir accepté l’inacceptable émergera au cours de la séance. A la fin de la séance, et une fois l’orage passé, je lui donne à nouveau des instructions d’évaluation des bénéfices. Bénéfices sur la question de la consommation de chemsex et sur la mesure de l’échelle « croire en moi ». Nous prévoyons de nous revoir comme à l’habitude environ un mois après.
À la séance suivante et septième entretien, M. X. met fièrement en avant qu’il n’a pas consommé depuis deux mois et demi. Nous pouvons donc évaluer que le rapport que mon patient entretient au chemsex a radicalement changé, notamment de par le traitement traumatique. En effet, l’abus sexuel et la réaction de ses parents en apprenant son homosexualité (sans jamais avoir eu connaissance de l’abus) avait, comme souvent, amené la découverte du chemsex comme une solution afin de désintriquer le trauma de la dynamique sexuelle, permettant au consommateur de découvrir un espace de plaisir totalement préservé.
La deuxième séance de mouvements oculaires, en touchant le point d’entrée dans une consommation à vocation d’oubli de la douleur amoureuse, a permis de recentrer le patient sur ses besoins et priorités. M. X. va mieux, tellement mieux, il dit : « maintenant je fais attention aux arbres, aux fleurs, au soleil et au jour bleu... ».
Nous nous concentrons sur la mesure des changements et les ancrons par le questionnement EDR (qu’est-ce qui va mieux ? qu’est-ce que cela change ? qu’est-ce que cela permet qui n’était pas possible avant ? comment s’en rend-il compte ? comment les autres pourraient le percevoir ? qu’est-ce que cela dit de lui-même ? pourquoi ? comment ? quoi d’autre ? et quoi encore ?... avec un balayage sur les émotions, les pensées et les actions).
Ce tissage permet un travail intégratif des bénéfices et leur ancrage en profondeur. Il pourra dire à quel point cela a bougé son niveau d’exigence envers lui-même, en acceptant de prendre du plaisir dans la vie. Il m’avouera qu’il était choqué, bien qu’il ait accepté cette tâche donnée au deuxième entretien, par le fait d’avoir le droit de prendre du plaisir. Le fait d’introduire la dimension du plaisir qu’il s’interdisait, en s’appuyant sur son niveau d’exigence, a permis de reconfigurer son rapport à ces deux points.
Il parle d’une renaissance en arrêtant de penser de manière incessante au passé et envisage même de reprendre des études de littérature. La mesure de l’échelle nous amène à un joli 8,5 qui lui permet de croire en lui et d’être son meilleur allié. La thérapie a bien atteint son objectif selon lui. Nous prévoyons une dernière séance dans deux mois afin de finaliser en sécurité toutes ses avancées.
Sur ce dernier et huitième entretien, M. X. n’a toujours pas refait de chemsex. Il a compris que le moteur de ses consommations était la honte et la culpabilité (sentiments souvent présents dans les traumas sexuels). Il évoque un mouvement intérieur profond, une guérison qu’il n’avait jamais pensé possible ni envisageable. Non seulement aujourd’hui il s’accepte mais se trouve enfin beau, me disant : « tu as guéri mon intime ». Le dernier entretien offre au thérapeute cette image magnifique de l’alignement de la personne ; l’alignement de ses actions sur ses intentions et ses valeurs, ainsi que celui de ses pensées, ses émotions et ses actions. Nous mesurons et ancrons avec les outils de l’ACS afin de le laisser reprendre plus légèrement le cours de sa vie, parvenant désormais à croire en lui.
NOTES
1. ACS : Approche Centrée Solution ;
EMDR :Eye Movement Desensitization and Reprocessing ;
IMO : Intégration par les Mouvements Oculaires.
EMDR - IMO: (appelée aussi EMDR Intégrative) développée par Laurent GROSS dans les années 2007
2. CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie pour la Prise en Charge
SOPHIE TOURNOUËR Psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de couple. Hypnothérapeute, spécialisation en psychotraumatisme.
Formatrice et superviseur au CHTIP COLLÈGE D’HYPNOSE ET THÉRAPIES INTÉGRATIVES DE PARIS, à l’Institut INDOLORE, à l’Institut HYPNOTIM.. Elle est Membre de France EMDR IMO.
Elle est formatrice entre autre sur l'Approche Centrée Solution dans le cadre du CHEMSEX.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Formation en Hypnose, EMDR et Cancérologie, approche intégrative.
De l'annonce du cancer, en passant par la gestion des effets secondaires de la chimiothérapie, de la radiothérapie et jusqu'a l'après-cancer. Une formation en hypnose et communication thérapeutique d'une journée avec un médecin sénologue, radiologue et hypnothérapeute à Paris.
L’annonce d’un cancer est une épreuve, un tournant dans la vie voire un tsunami pouvant entrainer une véritable sidération, une détresse émotionnelle et ceci malgré les améliorations thérapeutiques.
Aussi il est fondamental, dans notre société de plus en plus déshumanisée, de donner sa place à l’humain, à toutes les étapes du parcours patient.
Dans un but d'optimisation de la prise en charge, il apparait indispensable de savoir communiquer avec le patient pour gérer les peurs et les douleurs (induites ou non) et pour l'acceptation des protocoles, et ceci tout particulièrement pour les patients complexes ou dans un contexte de cancérologie.
Objectifs de la formation
Aide à l’acceptation du diagnostic, du traitement.
Accompagnement.
Gestion des effets secondaires.
Autonomisation des patients. L’après-cancer.
Développer une stratégie thérapeutique dans la prise en charge des symptômes, afin de pouvoir intégrer les techniques d’hypnose et de communication thérapeutique dans sa pratique clinique journalière.
Contenu de la formation
L’hypnose comme outil transversal.
Accompagnement.
Voir le programme
Dr Michèle FOURCHON Médecin radiologue et sénologue à l’Institut du Cancer à Montpellier (ICM) puis consultante en hypnose pour la Ligue contre le cancer et pour le Montpellier Institut du sein (MIS). Accompagne le patient en hypnose, EMDR Intégrative, que ce soit à la phase diagnostique, traitement ou post-traitement.
Cette journée de formation sous un format de Masterclass, est incluse dans la formation de 9 jours en hypnose médicale du CHTIP Collège Hypnose Thérapies Intégratives Paris * IN-DOLORE ou peut être suivie indépendamment.
Une formation pour les professionnels de santé.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
Aussi il est fondamental, dans notre société de plus en plus déshumanisée, de donner sa place à l’humain, à toutes les étapes du parcours patient.
Dans un but d'optimisation de la prise en charge, il apparait indispensable de savoir communiquer avec le patient pour gérer les peurs et les douleurs (induites ou non) et pour l'acceptation des protocoles, et ceci tout particulièrement pour les patients complexes ou dans un contexte de cancérologie.
Objectifs de la formation
Aide à l’acceptation du diagnostic, du traitement.
Accompagnement.
Gestion des effets secondaires.
Autonomisation des patients. L’après-cancer.
Développer une stratégie thérapeutique dans la prise en charge des symptômes, afin de pouvoir intégrer les techniques d’hypnose et de communication thérapeutique dans sa pratique clinique journalière.
Contenu de la formation
- Annonce du cancer.
- Redonner sa place à l’humain.
L’hypnose comme outil transversal.
- La dimension intégrative.
- Amélioration de la prise en charge
Accompagnement.
- Depuis l’annonce…
- Au cours du traitement. Gestion des effets secondaires.
- L’après-cancer.
Voir le programme
Dr Michèle FOURCHON Médecin radiologue et sénologue à l’Institut du Cancer à Montpellier (ICM) puis consultante en hypnose pour la Ligue contre le cancer et pour le Montpellier Institut du sein (MIS). Accompagne le patient en hypnose, EMDR Intégrative, que ce soit à la phase diagnostique, traitement ou post-traitement.
Cette journée de formation sous un format de Masterclass, est incluse dans la formation de 9 jours en hypnose médicale du CHTIP Collège Hypnose Thérapies Intégratives Paris * IN-DOLORE ou peut être suivie indépendamment.
Une formation pour les professionnels de santé.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Formation Certifiante en EMDR Intégrative, EMDR - IMO ®.
Des formations de EMDR Intégrative validées et certifiées par l'Association France EMDR-IMO ®.
La formation intégrative à la thérapie EMDR-IMO ® (EMDR Intégrative) permet à tous les professionnels de la santé, d’obtenir les compétences nécessaires pour accompagner la prise en charge efficace des psychotraumatismes, à la hauteur de leurs champs d’activités et de compétences.
Cette approche en EMDR Intégrative va donc pouvoir être adaptée à toutes les professions médicales et paramédicales rencontrant des patients présentant des symptômes liés au Trouble de Stress Post-Traumatique.
La thérapie EMDR-IMO ® regroupe différentes techniques modulables (DAP Désensibilisation par les Approches Paradoxales, GPC Gross Pain Control…) en fonction des problématiques des patients comme dans les cas de douleur chronique, de parcours de soin traumatique, de troubles alimentaires, de phobies, etc…
A l’occasion de cette formation très complète sur la thérapie EMDR-IMO ®, la richesse de l’enseignement repose sur des intervenants qui ont chacun une expertise dans le domaine du psychotrauma. La Dr Roxane Colette, médecin psychiatre (qui a notamment écrit un ouvrage sur l’IMO), Sophie Tournouër, psychologue et thérapeute familiale, spécialisée en Approches Centrées Solution, Laurent Gross qui a 40 ans d’expérience au niveau du psychotraumatisme et Laurence Adjadj, psychologue, psychothérapeute qui exerce à Marseille depuis plus de 12 ans.
Les 8 journées de formation se déroulent sur 3 sessions qui vous permettront de mettre en pratique la thérapie EMDR-IMO ® déjà dès la fin de la première session, grâce à de nombreux exercices, des simulations de cas en petits groupes, des jeux de rôles, des démonstrations des enseignants commentées en direct.
Puis, les débuts des sessions suivantes comprendront des moments de réajustements des pratiques, de l’intervision, afin de pouvoir acquérir toute la sécurité nécessaire pour travailler face à des situations traumatiques intenses, et les traumatismes complexes.
Les intervenants, approfondiront les techniques d’hypnose thérapeutique et feront le lien intégratif avec les thérapies brèves, les approches centrées vers la solution (ACS).
Cette formation pourra être complétée par des modules complémentaires de 2 jours, sur des thèmes importants comme les Addictions, et de la supervision.
Pour consulter le programme et les tarifs
Aussi, afin de pouvoir vous mettre en avant vos nouvelles compétences en tant que professionnel de la santé, vous aurez l’opportunité d’intégrer à l’issue de la formation, l’annuaire édité par l’Association France EMDR-IMO ®, Registre Officiel des Praticiens qui vous permettra de montrer votre crédibilité auprès du grand public, et de vos pairs.
En savoir plus sur les différentes formations en EMDR IMO :
Dates des prochaines formations sur l'agenda
S'inscrire aux prochaines sessions S'inscrire à la formation EMDR-IMO ® sur Paris.
S'inscrire à la formation EMDR-IMO ® sur Marseille.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
Cette approche en EMDR Intégrative va donc pouvoir être adaptée à toutes les professions médicales et paramédicales rencontrant des patients présentant des symptômes liés au Trouble de Stress Post-Traumatique.
La thérapie EMDR-IMO ® regroupe différentes techniques modulables (DAP Désensibilisation par les Approches Paradoxales, GPC Gross Pain Control…) en fonction des problématiques des patients comme dans les cas de douleur chronique, de parcours de soin traumatique, de troubles alimentaires, de phobies, etc…
A l’occasion de cette formation très complète sur la thérapie EMDR-IMO ®, la richesse de l’enseignement repose sur des intervenants qui ont chacun une expertise dans le domaine du psychotrauma. La Dr Roxane Colette, médecin psychiatre (qui a notamment écrit un ouvrage sur l’IMO), Sophie Tournouër, psychologue et thérapeute familiale, spécialisée en Approches Centrées Solution, Laurent Gross qui a 40 ans d’expérience au niveau du psychotraumatisme et Laurence Adjadj, psychologue, psychothérapeute qui exerce à Marseille depuis plus de 12 ans.
Les 8 journées de formation se déroulent sur 3 sessions qui vous permettront de mettre en pratique la thérapie EMDR-IMO ® déjà dès la fin de la première session, grâce à de nombreux exercices, des simulations de cas en petits groupes, des jeux de rôles, des démonstrations des enseignants commentées en direct.
Puis, les débuts des sessions suivantes comprendront des moments de réajustements des pratiques, de l’intervision, afin de pouvoir acquérir toute la sécurité nécessaire pour travailler face à des situations traumatiques intenses, et les traumatismes complexes.
Les intervenants, approfondiront les techniques d’hypnose thérapeutique et feront le lien intégratif avec les thérapies brèves, les approches centrées vers la solution (ACS).
Cette formation pourra être complétée par des modules complémentaires de 2 jours, sur des thèmes importants comme les Addictions, et de la supervision.
Pour consulter le programme et les tarifs
Aussi, afin de pouvoir vous mettre en avant vos nouvelles compétences en tant que professionnel de la santé, vous aurez l’opportunité d’intégrer à l’issue de la formation, l’annuaire édité par l’Association France EMDR-IMO ®, Registre Officiel des Praticiens qui vous permettra de montrer votre crédibilité auprès du grand public, et de vos pairs.
En savoir plus sur les différentes formations en EMDR IMO :
Dates des prochaines formations sur l'agenda
S'inscrire aux prochaines sessions S'inscrire à la formation EMDR-IMO ® sur Paris.
S'inscrire à la formation EMDR-IMO ® sur Marseille.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Formation à l’Hypnose Médicale dans la prise en charge du patient douloureux chronique - 9 jours à Paris
Objectifs:
- Acquisition des techniques d’hypnose et de communication thérapeutique utilisables sur les symptômes douloureux, les pathologies chroniques et les syndromes anxieux, en médecine et kinésithérapie.
- Intégration de ces techniques avec les autres approches antalgiques utilisées en pratique journalière.
- Développement d’une stratégie thérapeutique dans la prise en charge des symptômes douloureux, des troubles anxieux ou psychosomatiques chroniques.
- Optimisation de la relation soignant / soigné.
- Optimisation du confort du soignant face aux situations difficiles.
Public:
Médecins libéraux ou hospitaliers, Rhumatologues, Médecins Rééducateurs, Médecins du Sport, Kinésithérapeutes, Ostéopathes, Psychomotricien.ne.s, Ergothérapeutes et aux Infirmier.e.s.
Moyens Pédagogiques:
Exposés théoriques. Démonstrations et Analyses. Mises en situations pratiques supervisées, en petit groupe. Etudes de cas cliniques. Supports vidéo et documentation.
Particularité de la Formation:
Au cours de toute la formation, vous bénéficierez de l’enseignement, à chaque session, de 2 enseignants et de « facilitateurs » pendant les situations pratiques, afin d’assurer un meilleur suivi pédagogique.
Enseignants:
Tous les enseignants sont des professionnels de santé. Ils sont médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, IADE, psychologues, psychothérapeutes avec une expérience importante en hypnose médicale et dans la communication thérapeutique. Tous sont intervenants dans les congrès médicaux nationaux et internationaux, formateurs dans différentes écoles, à l’APHP et dans les Diplômes Universitaires.
En savoir plus sur la Formation Hypnose et Douleur Chronique à Paris
A l'issue de ce cycle de 9 jours, les étudiants pourront effectuer la formation en EMDR Intégrative (3 jours en EMDR IMO), pour l'intégrer dans leur pratique clinique, ainsi que l'ACS (Approche Centrée Solution) ou tout simplement intégrer le cycle Hypnothérapie.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
- Acquisition des techniques d’hypnose et de communication thérapeutique utilisables sur les symptômes douloureux, les pathologies chroniques et les syndromes anxieux, en médecine et kinésithérapie.
- Intégration de ces techniques avec les autres approches antalgiques utilisées en pratique journalière.
- Développement d’une stratégie thérapeutique dans la prise en charge des symptômes douloureux, des troubles anxieux ou psychosomatiques chroniques.
- Optimisation de la relation soignant / soigné.
- Optimisation du confort du soignant face aux situations difficiles.
Public:
Médecins libéraux ou hospitaliers, Rhumatologues, Médecins Rééducateurs, Médecins du Sport, Kinésithérapeutes, Ostéopathes, Psychomotricien.ne.s, Ergothérapeutes et aux Infirmier.e.s.
Moyens Pédagogiques:
Exposés théoriques. Démonstrations et Analyses. Mises en situations pratiques supervisées, en petit groupe. Etudes de cas cliniques. Supports vidéo et documentation.
Particularité de la Formation:
Au cours de toute la formation, vous bénéficierez de l’enseignement, à chaque session, de 2 enseignants et de « facilitateurs » pendant les situations pratiques, afin d’assurer un meilleur suivi pédagogique.
Enseignants:
Tous les enseignants sont des professionnels de santé. Ils sont médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, IADE, psychologues, psychothérapeutes avec une expérience importante en hypnose médicale et dans la communication thérapeutique. Tous sont intervenants dans les congrès médicaux nationaux et internationaux, formateurs dans différentes écoles, à l’APHP et dans les Diplômes Universitaires.
En savoir plus sur la Formation Hypnose et Douleur Chronique à Paris
A l'issue de ce cycle de 9 jours, les étudiants pourront effectuer la formation en EMDR Intégrative (3 jours en EMDR IMO), pour l'intégrer dans leur pratique clinique, ainsi que l'ACS (Approche Centrée Solution) ou tout simplement intégrer le cycle Hypnothérapie.
Diffusé par hypnose-ericksonienne.org
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Quand la douleur devient l'identité. Hors-Série 19 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves.
Se relier à sa mobilité relationnelle. « Seul au monde », isolé, hors de la relation humaine, le côté gauche du corps très douloureux. Tel est devenu l’état identitaire du patient dont le cas est exposé ici. Réunis dans la même « bulle », face à la scène imaginaire, ce patient et le thérapeute travaillent ensemble à la déconstruction de son identité de « corps douloureux » en s’appuyant sur les techniques des Thérapies narratives.
Lorsque le corps est douloureux depuis des années, la douleur devient la norme pour le système nerveux autonome comme si celle-ci définissait le lien au corps. Ainsi, la construction identitaire de la personne se résume à l’étiquette de « corps douloureux ». Le « je » et le symptôme se retrouvent intriqués dans un tout, qui l’enferme dans la maladie : « je suis fibromyalgique », « je suis lombalgique »... Chez certains patients, nous pourrions même dire que ce lien à la douleur devient le seul lien vivant à leur corps. C’est leur existence. Dans ce contexte, nous comprenons bien que si nous travaillons à supprimer la douleur, nous pouvons être amenés à devoir gérer soit de la résistance, soit un effondrement de la représentation du « je » de notre patient en perte de repères, ne sachant plus qui il est si la douleur n’est plus son identité.
Dans les deux cas, la construction d’une relation thérapeutique sécure va permettre de pouvoir prendre appui sur ce lien pour amener le patient à déjà observer ce lien existentiel à la douleur et de l’amener à prendre position. Le travail thérapeutique peut consister alors à assumer ce lien unique à la douleur, ou à développer un lien différent à la douleur. L’exploration de ce nouveau monde sensoriel se fera en toute sécurité avec le thérapeute au rythme du patient. D’un point de vue thérapeutique, il s’agira d’aller prendre appui sur cet espace douloureux qui représente un espace ressource pour le patient, au sens où c’est dans cet endroit que circule le plus de vie. A contrario, le reste du corps peut être vécu comme inexistant ou figé. C’est ce que nous allons développer dans le cas clinique ci-dessous. Cas de Monsieur B. Monsieur B. a 67 ans et vit seul. Il a vécu avec une femme quelques années avec laquelle il a eu un fils de 26 ans aujourd’hui. Cette rencontre s’était faite suite à une annonce dans une revue, la rencontre spontanée étant difficile pour lui et lui demandant beaucoup d’effort. Concernant son activité professionnelle, il a exercé le métier de professeur de mathématiques. Monsieur B. m’est envoyé par un collègue psychologue qui lui conseille de faire de la TLMR, Thérapie du lien et des mondes relationnels, dans l’idée de travailler sur ses nombreuses somatisations. « Je suis hypocondriaque et je suis un grand anxio-dépressif », c’est ainsi qu’il parle de lui lors de la première séance. Il m’explique que ses crises d’angoisse ont commencé à 17 ans, lorsqu’un de ses camarades de classe est décédé subitement. Il a passé son enfance seul avec sa mère et n’a rencontré son père qu’à l’âge de 8 ans, les rencontres n’étaient qu’épisodiques sans qu’un lien structurant père-fils ne soit établi véritablement. Sa maman l’a toujours surprotégé et leur relation était suffocante tellement elle vivait dans l’angoisse de le perdre. Ses parents sont maintenant décédés. Nous nous voyons en thérapie environ une fois par mois depuis neuf mois. Les premières séances ont permis de faire émerger ce que nous pouvions faire ensemble de différent des autres thérapies qu’il avait déjà faites. Il en ressort qu’il se sent très seul et isolé, sans aucune relation affective et qu’il souhaiterait avoir plus de facilité pour faire des rencontres. En s’appuyant sur les Thérapies narratives, nous travaillons ensemble pour personnifier et nommer ce monde dans lequel il vit de façon à rendre explicites les intentions relationnelles de ce monde dans lequel il est prisonnier. Nous commençons ainsi à déconstruire l’état identitaire de ce monde de « je suis seul au monde », que le patient et le thérapeute peuvent observer grâce aux externalisations sur la scène imaginaire devant eux. Quelle forme ce monde prend-il là devant nous ? Quels effets ont-ils sur lui et quelles intentions porte-t-il ? Le patient prend petit à petit conscience que le thérapeute observe lui aussi ce monde mais qu’il n’en fait pas partie.
Car pour ce patient, la normalité étant de vivre dans un environnement de « seul au monde », il est inconsciemment convaincu que même le thérapeute en fait partie. Il va falloir que ce dernier s’en différencie pour lui montrer que d’autres relations sont possibles. C’est ainsi que lors des premières séances, je lui propose d’observer ce qu’il y a chez moi qui commence à le mettre en sécurité dans notre relation. Il peut ainsi se relier à l’affect en lien avec ce ressenti et ce partage contribue à installer la relation humaine progressivement et à la densifier.
Lorsque Monsieur B. arrive à la séance écrite ci-dessous, il me dit qu’il ressent tout son côté gauche comme très douloureux et que pour la énième fois, son médecin lui a dit que tout allait bien, que tous les examens étaient négatifs. Nous allons donc commencer la séance en se connectant à la partie la plus vivante, la plus présente chez lui, c’est-à-dire la partie douloureuse.
Le thérapeute est assis dans un angle de 60 degrés avec son patient, de façon à permettre aux deux regards de se projeter vers l’avant dans cet espace de co-création, ce qui facilite l’accordage relationnel (1). Les mouvements alternatifs (MA) sont utilisés dans cette séance avec une vitesse différente selon l’intention thérapeutique. Lorsqu’ils sont faits lentement, ils vont permettre de focaliser l’attention à l’intérieur et d’ancrer corporellement la ressource en la densifiant. Et lorsqu’ils sont faits rapidement, ils vont permettre de dépotentialiser le mental ou un trop-plein d’émotion. Lors de la séance, nous utilisons souvent le « nous » incluant ainsi le thérapeute et le patient dans la même bulle. Ce dernier peut ainsi faire l’apprentissage d’une relation thérapeutique soutenante lui permettant d’être accompagné lors du travail.
Formation Certifiée par France EMDR IMO ®. La seule et unique Certification Officielle en EMDR IMO ® en Europe..
Cette formation vous permettra d'utiliser l'Intégration des Mouvements Oculaires en Thérapie avec les outils thérapeutiques que vous utilisez déjà en pratique clinique. (Hypnose, Approches Centrées Solution etc...)
Alors, rendez-vous à Paris, Marseille, Annecy, et bientôt Bordeaux, Nancy, Strasbourg, Lausanne et Genève, avec des instituts membres de la CFHTB, pour une formation réellement INTEGRATIVE.
www.formation-emdr.fr/
Agenda des prochaines formations
Annuaire de thérapeutes sur EMDR.FR
- Thérapeute : « Quand vous dites que tout votre côté gauche est douloureux, et que nous sommes ensemble, là maintenant dans cette séance, est-ce acceptable pour vous de bien vous connecter à cette partie gauche ? (De façon à bien le focaliser et pour dépotentialiser son mental, je place mes doigts devant lui et je propose à ses yeux de suivre mes doigts, nous faisons quelques mouvements alternatifs-MA.)
- Th. : Qu’est-ce qui est présent là maintenant ?
- Monsieur B. : Ça serre...
- Th. : OK, observons ensemble ce “ça” qui serre. (Nous repartons en MA. Ma posture est pleinement présente et bienveillante avec l’intention d’aller ensemble explorer cette sensation.)
- Th. : Qu’est-ce qui est présent là maintenant ?
- Monsieur B. : Ça serre...
- Th. : Et quand ça serre et que nous sommes là ensemble dans cette séance, avez-vous besoin de mon aide ou préférez-vous gérer seul ? (Cette proposition d’aide permet au thérapeute de voir si progressivement le thérapeute devient une personne sur laquelle le patient peut prendre appui dans un moment de détresse. Métaphoriquement, on pourrait dire qu’alors il n’appartient plus au monde dans lequel il vit où les relations ne permettent pas de prendre appui.) (2)
- Monsieur B. : Oui, je veux bien votre aide.
- Th. : Alors je vais me rapprocher de vous et proposer au dos de votre main droite de venir prendre appui dans la paume de ma main gauche. (Il pose sa main dans la mienne.)
- Th. : Très bien, et nous allons observer ensemble tout ce qu’il se passe entre nos deux mains. (MA)...
- Th. : Qu’est-ce qui est présent là maintenant ?
- Monsieur B. : C’est mieux...
- Th. : Ah... Et c’est comment ce mieux ?
- Monsieur B. : Il n’y a plus rien à gauche.
- Th. : Et quand il n’y a plus rien à gauche, à la place, il y a quoi ? (MA)...
- Monsieur B. : Quand il y a rien, il y a une libération d’énergie. Car tant que je sens un malaise quelque part, ça crée comme une paralysie physique, je ne peux pas agir.
- Th. : Là, quand vous êtes en train de me dire “ça crée comme une libération d’énergie”, est-ce que je peux vous demander d’observer, là maintenant, où est-ce qu’il y a le plus de libération d’énergie ? (Nous arrivons dans la partie ressource.) (MA)...
- Monsieur B. : Au niveau du haut du corps, comme si je pouvais prendre les choses à bras-le-corps.
- Th. : Ah... Donc c’est au niveau du haut du corps qu’il se passe quelque chose ?
- Monsieur B. : Oui, c’est ça.
- Th. : Et c’est confortable ?
- Monsieur B. : Oui.
- Th. : Je peux vous demander de bien vous connecter à cette sensation confortable au niveau du haut du corps ? (Nous repartons en MA, plus lents cette fois-ci, pour commencer à ancrer cette sensation dans son corps.)
- Monsieur B. : C’est comme si, au niveau des épaules, j’avais la capacité de prendre davantage de choses sur les épaules... -Th. : OK, et quand vous dites “c’est comme si, au niveau des épaules, j’avais la capacité de prendre davantage de choses sur les épaules”, c’est quelque chose que vous connaissez ou que vous êtes en train de découvrir ? (Le fait de répéter mot à mot ce qu’il vient de dire lui permet de rester focalisé sur le processus thérapeutique et de maintenir la transe. Je questionne l’existence d’un souvenir qui peut être ressource pour lui en lien avec cette expérience corporelle ou s’il s’agit d’une voie nouvelle à explorer ensemble.) (Nous repartons en MA...)
- Monsieur B. : Oui, je connais, mais c’est autant dans le sens physique que figuré. C’est-à-dire que j’ai une liste de choses à faire, et quand je suis suffisamment détendu, je prends cette liste et je peux agir. Ce qui n’est pas le cas quand je sens qu’un poumon respire mal, ou que j’ai mal au dos, ou quelque chose qui ne va pas, je m’interdis en quelque sorte d’agir.
- Th. : Quand vous dites “c’est quelque chose que je connais car en effet quand j’ai une liste de choses à faire et que j’ai cette sensation que les épaules et le haut du corps peuvent agir”, si je mets ma main là, devant nous, c’est quoi le premier souvenir qui vient se mettre en lien avec ? (Je place ma main gauche comme un écran devant nous dans l’intention de voir quel souvenir vient se mettre en lien avec cette expérience corporelle. Est-ce que cette sensation qu’il décrit est une représentation psychique qu’il se fait ou est-elle une expérience déjà vécue ?) (MA)...
- Monsieur B. : Il y a deux choses qui me viennent. D’une part d’être capable de travailler au jardin, et d’autre part, lorsque je vous ai vu à la dernière séance et où j’étais assez bien, dans la liste des choses à faire j’avais “m’inscrire à des voyages”, alors je me suis inscrit car j’allais bien. Et aujourd’hui où je me sens dans le creux de la vague, je me demande si j’ai bien fait de m’inscrire, est-ce que je vais réellement y aller, est-ce que j’en suis capable ? C’est l’action tant sur le plan physique que sur un plan de prise de décision.
- Th. : Donc si je comprends bien, quand je me mets en lien avec cette …
Lire la suite...
MARIE-ANNE JOLLY
Masseur-kinésithérapeute en libéral à Lannion (22).Elle a tout d’abord associé le massage chinois à sa pratique avant d’en faire autant pour l’hypnose. Toujours en quête d’apprendre et d’élargir ses connaissances, elle se forme aussi en sexocorporel, en thérapies narratives et en Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR). Elle partage régulièrement son expérience sur l’apport de l’hypnose dans sa pratique professionnelle en congrès, par des articles, des publications et comme formatrice.
Commandez ce Hors-série de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves n°19 SOMMAIRE
06 / Éditorial Troubles Psychosomatiques S’engager dans une médecine plus holistique bio-psycho-sociale J. Betbèze
10 / Avant-propos Une exploration de territoires où corps et esprit se rejoignent E. Bardot et S. Roy
12 / En couverture Anne Donzé et Vincent Chagnon S. Cohen
14 / Le pouvoir de l’eczéma Décontaminer le parent des effets du symptôme V. Bardot
28 / Psoriasis géant De la pensée opératoire à la pensée symbolique par la Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR) S. Roy
40 / Psychosomatique et dermatologie : La peau, métaphore de la relation V. Bonnet
52 / Maux de tête et désir de perfection Sensations, externalisation et TLMR É. Bardot
71 / La controverse de médecine psychosomatique Entre corps et esprit, une fracture médicale et philosophique G. Ostermann
78 / Grand Entretien Jean Benjamin Stora et la psychosomatique intégrative G. Ostermann
94 / La psychosomatique, un phénomène hypnotique protecteur Sensations, émotions et PTR G. Brassine
106 / Honte et brûlures du cou Le symptôme somatique persistant M. Faucoup
120 / Ostéopathie et psychosomatique Enjeux et apports de la « double casquette ». Algoneurodystrophie et de douleurs abdominales P. Pétillot
134 / Quand la douleur devient l’identité Se relier à sa mobilité relationnelle M.-A. Jolly
146 / Trouble fonctionnel intestinal et syndrome anxiodépressif Signaux idéomoteurs et psychosomatiques S. Radoykov
152 / Asthme et créativité Les suggestions posthypnotiques de Proust P. Kivits
164 / L’hypnose thérapeutique, de quoi parle-t-on ? Un échange croisé, autour de l’hypnose thérapeutique É. Bardot, J. Betbèze et S. Roy
172 / Poême Ce corps K. Ficini
Dans les deux cas, la construction d’une relation thérapeutique sécure va permettre de pouvoir prendre appui sur ce lien pour amener le patient à déjà observer ce lien existentiel à la douleur et de l’amener à prendre position. Le travail thérapeutique peut consister alors à assumer ce lien unique à la douleur, ou à développer un lien différent à la douleur. L’exploration de ce nouveau monde sensoriel se fera en toute sécurité avec le thérapeute au rythme du patient. D’un point de vue thérapeutique, il s’agira d’aller prendre appui sur cet espace douloureux qui représente un espace ressource pour le patient, au sens où c’est dans cet endroit que circule le plus de vie. A contrario, le reste du corps peut être vécu comme inexistant ou figé. C’est ce que nous allons développer dans le cas clinique ci-dessous. Cas de Monsieur B. Monsieur B. a 67 ans et vit seul. Il a vécu avec une femme quelques années avec laquelle il a eu un fils de 26 ans aujourd’hui. Cette rencontre s’était faite suite à une annonce dans une revue, la rencontre spontanée étant difficile pour lui et lui demandant beaucoup d’effort. Concernant son activité professionnelle, il a exercé le métier de professeur de mathématiques. Monsieur B. m’est envoyé par un collègue psychologue qui lui conseille de faire de la TLMR, Thérapie du lien et des mondes relationnels, dans l’idée de travailler sur ses nombreuses somatisations. « Je suis hypocondriaque et je suis un grand anxio-dépressif », c’est ainsi qu’il parle de lui lors de la première séance. Il m’explique que ses crises d’angoisse ont commencé à 17 ans, lorsqu’un de ses camarades de classe est décédé subitement. Il a passé son enfance seul avec sa mère et n’a rencontré son père qu’à l’âge de 8 ans, les rencontres n’étaient qu’épisodiques sans qu’un lien structurant père-fils ne soit établi véritablement. Sa maman l’a toujours surprotégé et leur relation était suffocante tellement elle vivait dans l’angoisse de le perdre. Ses parents sont maintenant décédés. Nous nous voyons en thérapie environ une fois par mois depuis neuf mois. Les premières séances ont permis de faire émerger ce que nous pouvions faire ensemble de différent des autres thérapies qu’il avait déjà faites. Il en ressort qu’il se sent très seul et isolé, sans aucune relation affective et qu’il souhaiterait avoir plus de facilité pour faire des rencontres. En s’appuyant sur les Thérapies narratives, nous travaillons ensemble pour personnifier et nommer ce monde dans lequel il vit de façon à rendre explicites les intentions relationnelles de ce monde dans lequel il est prisonnier. Nous commençons ainsi à déconstruire l’état identitaire de ce monde de « je suis seul au monde », que le patient et le thérapeute peuvent observer grâce aux externalisations sur la scène imaginaire devant eux. Quelle forme ce monde prend-il là devant nous ? Quels effets ont-ils sur lui et quelles intentions porte-t-il ? Le patient prend petit à petit conscience que le thérapeute observe lui aussi ce monde mais qu’il n’en fait pas partie.
Car pour ce patient, la normalité étant de vivre dans un environnement de « seul au monde », il est inconsciemment convaincu que même le thérapeute en fait partie. Il va falloir que ce dernier s’en différencie pour lui montrer que d’autres relations sont possibles. C’est ainsi que lors des premières séances, je lui propose d’observer ce qu’il y a chez moi qui commence à le mettre en sécurité dans notre relation. Il peut ainsi se relier à l’affect en lien avec ce ressenti et ce partage contribue à installer la relation humaine progressivement et à la densifier.
Lorsque Monsieur B. arrive à la séance écrite ci-dessous, il me dit qu’il ressent tout son côté gauche comme très douloureux et que pour la énième fois, son médecin lui a dit que tout allait bien, que tous les examens étaient négatifs. Nous allons donc commencer la séance en se connectant à la partie la plus vivante, la plus présente chez lui, c’est-à-dire la partie douloureuse.
Le thérapeute est assis dans un angle de 60 degrés avec son patient, de façon à permettre aux deux regards de se projeter vers l’avant dans cet espace de co-création, ce qui facilite l’accordage relationnel (1). Les mouvements alternatifs (MA) sont utilisés dans cette séance avec une vitesse différente selon l’intention thérapeutique. Lorsqu’ils sont faits lentement, ils vont permettre de focaliser l’attention à l’intérieur et d’ancrer corporellement la ressource en la densifiant. Et lorsqu’ils sont faits rapidement, ils vont permettre de dépotentialiser le mental ou un trop-plein d’émotion. Lors de la séance, nous utilisons souvent le « nous » incluant ainsi le thérapeute et le patient dans la même bulle. Ce dernier peut ainsi faire l’apprentissage d’une relation thérapeutique soutenante lui permettant d’être accompagné lors du travail.
Formation Certifiée par France EMDR IMO ®. La seule et unique Certification Officielle en EMDR IMO ® en Europe..
Cette formation vous permettra d'utiliser l'Intégration des Mouvements Oculaires en Thérapie avec les outils thérapeutiques que vous utilisez déjà en pratique clinique. (Hypnose, Approches Centrées Solution etc...)
Alors, rendez-vous à Paris, Marseille, Annecy, et bientôt Bordeaux, Nancy, Strasbourg, Lausanne et Genève, avec des instituts membres de la CFHTB, pour une formation réellement INTEGRATIVE.
www.formation-emdr.fr/
Agenda des prochaines formations
Annuaire de thérapeutes sur EMDR.FR
- Thérapeute : « Quand vous dites que tout votre côté gauche est douloureux, et que nous sommes ensemble, là maintenant dans cette séance, est-ce acceptable pour vous de bien vous connecter à cette partie gauche ? (De façon à bien le focaliser et pour dépotentialiser son mental, je place mes doigts devant lui et je propose à ses yeux de suivre mes doigts, nous faisons quelques mouvements alternatifs-MA.)
- Th. : Qu’est-ce qui est présent là maintenant ?
- Monsieur B. : Ça serre...
- Th. : OK, observons ensemble ce “ça” qui serre. (Nous repartons en MA. Ma posture est pleinement présente et bienveillante avec l’intention d’aller ensemble explorer cette sensation.)
- Th. : Qu’est-ce qui est présent là maintenant ?
- Monsieur B. : Ça serre...
- Th. : Et quand ça serre et que nous sommes là ensemble dans cette séance, avez-vous besoin de mon aide ou préférez-vous gérer seul ? (Cette proposition d’aide permet au thérapeute de voir si progressivement le thérapeute devient une personne sur laquelle le patient peut prendre appui dans un moment de détresse. Métaphoriquement, on pourrait dire qu’alors il n’appartient plus au monde dans lequel il vit où les relations ne permettent pas de prendre appui.) (2)
- Monsieur B. : Oui, je veux bien votre aide.
- Th. : Alors je vais me rapprocher de vous et proposer au dos de votre main droite de venir prendre appui dans la paume de ma main gauche. (Il pose sa main dans la mienne.)
- Th. : Très bien, et nous allons observer ensemble tout ce qu’il se passe entre nos deux mains. (MA)...
- Th. : Qu’est-ce qui est présent là maintenant ?
- Monsieur B. : C’est mieux...
- Th. : Ah... Et c’est comment ce mieux ?
- Monsieur B. : Il n’y a plus rien à gauche.
- Th. : Et quand il n’y a plus rien à gauche, à la place, il y a quoi ? (MA)...
- Monsieur B. : Quand il y a rien, il y a une libération d’énergie. Car tant que je sens un malaise quelque part, ça crée comme une paralysie physique, je ne peux pas agir.
- Th. : Là, quand vous êtes en train de me dire “ça crée comme une libération d’énergie”, est-ce que je peux vous demander d’observer, là maintenant, où est-ce qu’il y a le plus de libération d’énergie ? (Nous arrivons dans la partie ressource.) (MA)...
- Monsieur B. : Au niveau du haut du corps, comme si je pouvais prendre les choses à bras-le-corps.
- Th. : Ah... Donc c’est au niveau du haut du corps qu’il se passe quelque chose ?
- Monsieur B. : Oui, c’est ça.
- Th. : Et c’est confortable ?
- Monsieur B. : Oui.
- Th. : Je peux vous demander de bien vous connecter à cette sensation confortable au niveau du haut du corps ? (Nous repartons en MA, plus lents cette fois-ci, pour commencer à ancrer cette sensation dans son corps.)
- Monsieur B. : C’est comme si, au niveau des épaules, j’avais la capacité de prendre davantage de choses sur les épaules... -Th. : OK, et quand vous dites “c’est comme si, au niveau des épaules, j’avais la capacité de prendre davantage de choses sur les épaules”, c’est quelque chose que vous connaissez ou que vous êtes en train de découvrir ? (Le fait de répéter mot à mot ce qu’il vient de dire lui permet de rester focalisé sur le processus thérapeutique et de maintenir la transe. Je questionne l’existence d’un souvenir qui peut être ressource pour lui en lien avec cette expérience corporelle ou s’il s’agit d’une voie nouvelle à explorer ensemble.) (Nous repartons en MA...)
- Monsieur B. : Oui, je connais, mais c’est autant dans le sens physique que figuré. C’est-à-dire que j’ai une liste de choses à faire, et quand je suis suffisamment détendu, je prends cette liste et je peux agir. Ce qui n’est pas le cas quand je sens qu’un poumon respire mal, ou que j’ai mal au dos, ou quelque chose qui ne va pas, je m’interdis en quelque sorte d’agir.
- Th. : Quand vous dites “c’est quelque chose que je connais car en effet quand j’ai une liste de choses à faire et que j’ai cette sensation que les épaules et le haut du corps peuvent agir”, si je mets ma main là, devant nous, c’est quoi le premier souvenir qui vient se mettre en lien avec ? (Je place ma main gauche comme un écran devant nous dans l’intention de voir quel souvenir vient se mettre en lien avec cette expérience corporelle. Est-ce que cette sensation qu’il décrit est une représentation psychique qu’il se fait ou est-elle une expérience déjà vécue ?) (MA)...
- Monsieur B. : Il y a deux choses qui me viennent. D’une part d’être capable de travailler au jardin, et d’autre part, lorsque je vous ai vu à la dernière séance et où j’étais assez bien, dans la liste des choses à faire j’avais “m’inscrire à des voyages”, alors je me suis inscrit car j’allais bien. Et aujourd’hui où je me sens dans le creux de la vague, je me demande si j’ai bien fait de m’inscrire, est-ce que je vais réellement y aller, est-ce que j’en suis capable ? C’est l’action tant sur le plan physique que sur un plan de prise de décision.
- Th. : Donc si je comprends bien, quand je me mets en lien avec cette …
Lire la suite...
MARIE-ANNE JOLLY
Masseur-kinésithérapeute en libéral à Lannion (22).Elle a tout d’abord associé le massage chinois à sa pratique avant d’en faire autant pour l’hypnose. Toujours en quête d’apprendre et d’élargir ses connaissances, elle se forme aussi en sexocorporel, en thérapies narratives et en Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR). Elle partage régulièrement son expérience sur l’apport de l’hypnose dans sa pratique professionnelle en congrès, par des articles, des publications et comme formatrice.
Commandez ce Hors-série de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves n°19 SOMMAIRE
06 / Éditorial Troubles Psychosomatiques S’engager dans une médecine plus holistique bio-psycho-sociale J. Betbèze
10 / Avant-propos Une exploration de territoires où corps et esprit se rejoignent E. Bardot et S. Roy
12 / En couverture Anne Donzé et Vincent Chagnon S. Cohen
14 / Le pouvoir de l’eczéma Décontaminer le parent des effets du symptôme V. Bardot
28 / Psoriasis géant De la pensée opératoire à la pensée symbolique par la Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR) S. Roy
40 / Psychosomatique et dermatologie : La peau, métaphore de la relation V. Bonnet
52 / Maux de tête et désir de perfection Sensations, externalisation et TLMR É. Bardot
71 / La controverse de médecine psychosomatique Entre corps et esprit, une fracture médicale et philosophique G. Ostermann
78 / Grand Entretien Jean Benjamin Stora et la psychosomatique intégrative G. Ostermann
94 / La psychosomatique, un phénomène hypnotique protecteur Sensations, émotions et PTR G. Brassine
106 / Honte et brûlures du cou Le symptôme somatique persistant M. Faucoup
120 / Ostéopathie et psychosomatique Enjeux et apports de la « double casquette ». Algoneurodystrophie et de douleurs abdominales P. Pétillot
134 / Quand la douleur devient l’identité Se relier à sa mobilité relationnelle M.-A. Jolly
146 / Trouble fonctionnel intestinal et syndrome anxiodépressif Signaux idéomoteurs et psychosomatiques S. Radoykov
152 / Asthme et créativité Les suggestions posthypnotiques de Proust P. Kivits
164 / L’hypnose thérapeutique, de quoi parle-t-on ? Un échange croisé, autour de l’hypnose thérapeutique É. Bardot, J. Betbèze et S. Roy
172 / Poême Ce corps K. Ficini
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Ostéopathie et psychosomatique. Hors-Série 19 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves.
A propos d'algodystrophie et de douleurs abdominales. Enjeux et apports de la double casquette. D’un côté l’ostéopathe, de l’autre l’hypnothérapeute. Dans sa pratique à « double casquette », l’auteur traite aussi bien les maux que les mots, à la croisée du corporel, de l’émotionnel et de la psychosomatique, en veillant à respecter la temporalité des patients.
Un problème physique est dit « psychosomatique » lorsqu’il est « caractérisé par la transformation d’un trouble psychologique en un trouble somatique (organique) » (Larousse). Mais Jean Benjamin Stora, psychosomaticien et créateur de l’Ecole de psychosomatique de la Pitié-Salpêtrière, nous dit : « Il n’y a pas de maladie psychosomatique, mais toutes les maladies sont psychosomatiques. » Il propose un nouveau paradigme : « L’homme est une unité psychosomatique. » Cette vision holistique est en parfaite adéquation avec la philosophie de l’ostéopathie et sous-tend ma pratique quotidienne. Toutefois, afin de clarifier mon propos dans cet article, je précise que j’y entendrai par « trouble à composante psychosomatique » toute plainte pouvant prendre, au moins en partie, sa source dans le vécu émotionnel/ affectif de la personne, que ce vécu soit présent ou passé. La plupart des professionnels du soin sont régulièrement en contact avec ces problématiques, et nombreux sont celles et ceux qui se forment à l’hypnose, aux thérapies brèves et autres approches thérapeutiques, tout en exerçant leur activité initiale.
Médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes, kinésithérapeutes, etc., enrichissent ainsi leur pratique en développant des compétences nouvelles dont l’intégration peut prendre des formes variées. Certains utilisent de façon subtile et non formelle des éléments comme l’hypnose conversationnelle, des techniques de questionnement, etc. D’autres, avec le temps, vont jusqu’à distinguer leur activité initiale de celle de thérapeute, tout en exerçant ces deux pratiques au sein d’un même espace. J’entends ici par « thérapie » toute pratique à visée psychothérapeutique (hypnothérapie, thérapies psychocorporelles, thérapies systémiques, etc.). Cette pluralité me concerne directement : ostéopathe de métier, je suis aussi hypnothérapeute, formé à la pratique de l’hypnose ericksonienne, aux thérapies brèves et à la Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR).
Mon intérêt pour ces approches est né de deux constats : d’une part, l’impact déterminant de la qualité de la relation thérapeutique sur les effets des séances d’ostéopathie ; d’autre part, l’observation de la fréquence élevée des troubles physiques à composante psychosomatique. Nous aborderons dans un premier temps les enjeux, dans les métiers du soin, de la mise en application de compétences considérées comme étant en dehors du cadre habituel et « attendu ». Puis nous verrons une manière dont le cadre d’intervention peut être redéfini. Enfin, deux exemples cliniques viendront illustrer la manière dont le questionnement peut aider à l’accordage entre le patient et le thérapeute autour de ces limites. Les enjeux de la « double casquette » Le développement et la mise en pratique de ces nouveaux apprentissages induisent, me semble-t-il, une inévitable transformation du cadre d’intervention, et imposent d’en (re)définir les limites. Surtout lorsque, progressivement, commence à se dessiner chez le praticien cette « seconde casquette » qui est celle de thérapeute. Et il semble que, même dans les cabinets où la pratique est double, et pour les motifs pouvant comporter une dimension psychosomatique, les patients viennent majoritairement consulter en premier lieu le professionnel du « physique » (le kinésithérapeute, le médecin, l’ostéopathe, etc.).
Probablement parce qu’il peut paraître moins engageant d’adopter la position « occupez-vous de mon corps », plutôt que « occupez-vous de moi ». Le défi réside dans cette transition délicate, lorsqu’elle est dictée par le processus thérapeutique, d’amener le patient à s’engager dans un travail avec une dimension plus « thérapeutique ». Lorsqu’un patient nous consulte, il vient généralement nous voir « en tant que... » sage-femme, infirmier, psychothérapeute, etc. Il arrive avec une représentation, plus ou moins précise, de ce qu’il peut attendre du cadre dans lequel la consultation se déroule. Cette vision résulte des interactions entre son parcours de vie et les représentations du contexte sociétal dans lequel il évolue. Elle influence directement son engagement potentiel dans le soin. Plus notre façon de travailler s’éloigne de ces représentations, plus elle peut créer de la confusion et susciter un sentiment d’insécurité. J’ai pu observer ce phénomène à plusieurs reprises, par exemple lors de questionnements trop « orientés psy » ou à des propositions de « travail en hypnose » introduites trop tôt.
Les réactions vont alors de la résistance subtile dans la prise en charge à l’arrêt complet du suivi. Ces expériences m’ont appris l’importance, tout particulièrement face aux troubles à composante psychosomatique, de proposer un espace structuré par des limites claires. C’est dans ce contexte, propice au sentiment de sécurité, à l’établissement d’une relation de confiance et à la prise de position, que patient et thérapeute peuvent s’engager ensemble dans le travail. Exemple d’un dispositif à double activité Le cadre d’intervention proposé aujourd’hui dans mon cabinet prend la forme présentée dans le schéma suivant. Celui-ci n’est pas explicité de façon systématique, mais il est un guide permanent dans ma posture professionnelle et ma pratique.
Formation Certifiée par France EMDR IMO ®. La seule et unique Certification Officielle en EMDR IMO ® en Europe..
Cette formation vous permettra d'utiliser l'Intégration des Mouvements Oculaires en Thérapie avec les outils thérapeutiques que vous utilisez déjà en pratique clinique. (Hypnose, Approches Centrées Solution etc...)
Alors, rendez-vous à Paris, Marseille, Annecy, et bientôt Bordeaux, Nancy, Strasbourg, Lausanne et Genève, avec des instituts membres de la CFHTB, pour une formation réellement INTEGRATIVE.
www.formation-emdr.fr/
Agenda des prochaines formations
Annuaire de thérapeutes sur EMDR.FR
L’espace de travail (1) peut être défini comme « un lieu de mise en place du processus aidant le patient à résoudre son problème ». À l’intérieur de celui-ci, nous distinguons trois sous-parties :
- Le cadre « ostéopathie » (2) ;
- Le cadre « thérapie » (3) ;
- Et l’espace de « réflexion » (4). Ce dernier est dédié aux échanges sur les attentes, afin d’y déterminer s’il s’agit d’engager un travail ostéopathique ou thérapeutique. C’est principalement au sein de cet espace de réflexion que se situent les questions que nous verrons dans les illustrations cliniques, ainsi que les explications, si nécessaire, de ce qui peut se passer dans chacun des deux autres cadres (ostéopathie ou thérapie). Lorsque les attentes sont claires dès le départ, le passage y est bref, mais il peut parfois nécessiter le temps d’une séance entière. Il est alors important d’expliciter que c’est dans cet espace que nous sommes. Et puisqu’il s’agit d’un temps amenant à la prise de position, il comporte déjà des effets thérapeutiques potentiels. Je considère chaque démarrage de consultation comme une entrée, en premier lieu, dans l’espace de travail (1). Les motifs qui m’y sont présentés par les patients sont à 80 % d’ordre somatique (douleurs, troubles digestifs, fatigue, etc.), en lien avec ma base ostéopathique. Les autres motifs sont variés et proches de ceux rencontrés dans les cabinets de psychothérapie. Pour les motifs d’ordre somatique, il existe un continuum dans la représentation des causes perçues par les patients, allant d’une vision strictement « mécanique » à une perception plus « psycho-émotionnelle », avec des degrés variés de combinaison entre les deux. Et puisque cette représentation influence directement l’éventualité d’un travail plus thérapeutique, j’y porte une attention particulière dans mon écoute.
DEUX ILLUSTRATIONS CLINIQUES
1. Algoneurodystrophie Afin d’illustrer mon propos, commençons avec l’exemple de Jérôme. Ce jeune sportif de 20 ans fait partie de ces patients « partants pour tout ». Il s’est fracturé le plateau tibial en jouant au volley il y a dix-huit mois. Il a ensuite développé une algoneurodystrophie du genou gauche qui a duré quelques mois. Lorsqu’il vient me voir, il va déjà mieux et les examens médicaux sont bons, mais il décrit des douleurs résiduelles et une appréhension qui l’empêchent de courir. Il me dit aussi : « C’est bizarre, je ne le sens pas comme l’autre, il est engourdi. » Comme j’ai un léger doute sur le fait qu’il vient bien me voir en tant qu’ostéopathe, je lui demande :
- Thérapeute : « Est-ce que je peux vous demander comment vous avez eu mon nom ?
- Jérôme : C’est avec un ami, vous lui avez débloqué le dos.
- Th. : D’accord, donc il vous a parlé de moi en tant qu’ostéopathe j’imagine ?
- Jérôme : C’est ça. Par contre j’ai vu que vous faisiez aussi de l’hypnose.
- Th. : C’est vrai. Et qu’est-ce qui vous a plutôt décidé à prendre rendez-vous avec moi ? Le conseil de votre ami ? Ou que je fasse de l’hypnose ?
- Jérôme : Que vous fassiez de l’hypnose. J’ai entendu dire que ça pouvait aider pour les douleurs.
- Th. : Ah, et vous vous demandez si ça pourrait aussi vous aider ?
- Jérôme : Oui, clairement, s’il y a des chances que ça m’aide, je veux bien. Vous pensez que ça pourrait améliorer ?
- Th. : C’est une bonne question. Parfois quand certaines douleurs persistent au lieu de rentrer dans l’ordre, il y a une part émotionnelle qui peut être liée... en lien avec l’accident ou avec d’autres choses. Et ça peut faire obstacle. L’hypnose peut aider pour lever ce qui fait obstacle. (J’adopte une approche ouverte, succincte, en gardant une position de réserve quant aux résultats possibles. Ses réponses verbales et non verbales guideront notre démarche.)
- Jérôme : C’est sûr que l’accident, ce n’était pas rien pour moi, moi qui fais beaucoup de sport, ça m’a mis un coup. S’il faut travailler ça, je veux bien. (A l’entendre et à l’observer, je perçois chez lui une réelle motivation. Je m’autorise donc à proposer directement une façon de travailler ensemble.)
- Th. : D’accord. Est-ce que ça vous convient si je vous explique comment je travaille et comment on pourrait procéder ?
- Jérôme : Bien sûr.
- Th. : Comme votre ami vous a conseillé de venir me voir, je vous propose qu’on commence par une ou deux séances d’ostéopathie. En fonction de l’évolution, si des obstacles persistent, on verra s’il peut être intéressant de continuer ce travail avec l’hypnose. Qu’en dites-vous ?
- Jérôme : Ça me va très bien. »
Lire la suite...
Pierre PETILLOT
Ostéopathe et hypnothérapeute en libéral à Vannes dans le Morbihan. Formée aux thérapies brèves et à la thérapie du lien et des modes relationnels. Formateur en TLMR
Commandez ce Hors-série de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves n°19 SOMMAIRE
06 / Éditorial Troubles Psychosomatiques S’engager dans une médecine plus holistique bio-psycho-sociale J. Betbèze
10 / Avant-propos Une exploration de territoires où corps et esprit se rejoignent E. Bardot et S. Roy
12 / En couverture Anne Donzé et Vincent Chagnon S. Cohen
14 / Le pouvoir de l’eczéma Décontaminer le parent des effets du symptôme V. Bardot
28 / Psoriasis géant De la pensée opératoire à la pensée symbolique par la Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR) S. Roy
40 / Psychosomatique et dermatologie : La peau, métaphore de la relation V. Bonnet
52 / Maux de tête et désir de perfection Sensations, externalisation et TLMR É. Bardot
71 / La controverse de médecine psychosomatique Entre corps et esprit, une fracture médicale et philosophique G. Ostermann
78 / Grand Entretien Jean Benjamin Stora et la psychosomatique intégrative G. Ostermann
94 / La psychosomatique, un phénomène hypnotique protecteur Sensations, émotions et PTR G. Brassine
106 / Honte et brûlures du cou Le symptôme somatique persistant M. Faucoup
120 / Ostéopathie et psychosomatique Enjeux et apports de la « double casquette ». Algoneurodystrophie et de douleurs abdominales P. Pétillot
134 / Quand la douleur devient l’identité Se relier à sa mobilité relationnelle M.-A. Jolly
146 / Trouble fonctionnel intestinal et syndrome anxiodépressif Signaux idéomoteurs et psychosomatiques S. Radoykov
152 / Asthme et créativité Les suggestions posthypnotiques de Proust P. Kivits
164 / L’hypnose thérapeutique, de quoi parle-t-on ? Un échange croisé, autour de l’hypnose thérapeutique É. Bardot, J. Betbèze et S. Roy
172 / Poême Ce corps K. Ficini
Médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes, kinésithérapeutes, etc., enrichissent ainsi leur pratique en développant des compétences nouvelles dont l’intégration peut prendre des formes variées. Certains utilisent de façon subtile et non formelle des éléments comme l’hypnose conversationnelle, des techniques de questionnement, etc. D’autres, avec le temps, vont jusqu’à distinguer leur activité initiale de celle de thérapeute, tout en exerçant ces deux pratiques au sein d’un même espace. J’entends ici par « thérapie » toute pratique à visée psychothérapeutique (hypnothérapie, thérapies psychocorporelles, thérapies systémiques, etc.). Cette pluralité me concerne directement : ostéopathe de métier, je suis aussi hypnothérapeute, formé à la pratique de l’hypnose ericksonienne, aux thérapies brèves et à la Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR).
Mon intérêt pour ces approches est né de deux constats : d’une part, l’impact déterminant de la qualité de la relation thérapeutique sur les effets des séances d’ostéopathie ; d’autre part, l’observation de la fréquence élevée des troubles physiques à composante psychosomatique. Nous aborderons dans un premier temps les enjeux, dans les métiers du soin, de la mise en application de compétences considérées comme étant en dehors du cadre habituel et « attendu ». Puis nous verrons une manière dont le cadre d’intervention peut être redéfini. Enfin, deux exemples cliniques viendront illustrer la manière dont le questionnement peut aider à l’accordage entre le patient et le thérapeute autour de ces limites. Les enjeux de la « double casquette » Le développement et la mise en pratique de ces nouveaux apprentissages induisent, me semble-t-il, une inévitable transformation du cadre d’intervention, et imposent d’en (re)définir les limites. Surtout lorsque, progressivement, commence à se dessiner chez le praticien cette « seconde casquette » qui est celle de thérapeute. Et il semble que, même dans les cabinets où la pratique est double, et pour les motifs pouvant comporter une dimension psychosomatique, les patients viennent majoritairement consulter en premier lieu le professionnel du « physique » (le kinésithérapeute, le médecin, l’ostéopathe, etc.).
Probablement parce qu’il peut paraître moins engageant d’adopter la position « occupez-vous de mon corps », plutôt que « occupez-vous de moi ». Le défi réside dans cette transition délicate, lorsqu’elle est dictée par le processus thérapeutique, d’amener le patient à s’engager dans un travail avec une dimension plus « thérapeutique ». Lorsqu’un patient nous consulte, il vient généralement nous voir « en tant que... » sage-femme, infirmier, psychothérapeute, etc. Il arrive avec une représentation, plus ou moins précise, de ce qu’il peut attendre du cadre dans lequel la consultation se déroule. Cette vision résulte des interactions entre son parcours de vie et les représentations du contexte sociétal dans lequel il évolue. Elle influence directement son engagement potentiel dans le soin. Plus notre façon de travailler s’éloigne de ces représentations, plus elle peut créer de la confusion et susciter un sentiment d’insécurité. J’ai pu observer ce phénomène à plusieurs reprises, par exemple lors de questionnements trop « orientés psy » ou à des propositions de « travail en hypnose » introduites trop tôt.
Les réactions vont alors de la résistance subtile dans la prise en charge à l’arrêt complet du suivi. Ces expériences m’ont appris l’importance, tout particulièrement face aux troubles à composante psychosomatique, de proposer un espace structuré par des limites claires. C’est dans ce contexte, propice au sentiment de sécurité, à l’établissement d’une relation de confiance et à la prise de position, que patient et thérapeute peuvent s’engager ensemble dans le travail. Exemple d’un dispositif à double activité Le cadre d’intervention proposé aujourd’hui dans mon cabinet prend la forme présentée dans le schéma suivant. Celui-ci n’est pas explicité de façon systématique, mais il est un guide permanent dans ma posture professionnelle et ma pratique.
Formation Certifiée par France EMDR IMO ®. La seule et unique Certification Officielle en EMDR IMO ® en Europe..
Cette formation vous permettra d'utiliser l'Intégration des Mouvements Oculaires en Thérapie avec les outils thérapeutiques que vous utilisez déjà en pratique clinique. (Hypnose, Approches Centrées Solution etc...)
Alors, rendez-vous à Paris, Marseille, Annecy, et bientôt Bordeaux, Nancy, Strasbourg, Lausanne et Genève, avec des instituts membres de la CFHTB, pour une formation réellement INTEGRATIVE.
www.formation-emdr.fr/
Agenda des prochaines formations
Annuaire de thérapeutes sur EMDR.FR
L’espace de travail (1) peut être défini comme « un lieu de mise en place du processus aidant le patient à résoudre son problème ». À l’intérieur de celui-ci, nous distinguons trois sous-parties :
- Le cadre « ostéopathie » (2) ;
- Le cadre « thérapie » (3) ;
- Et l’espace de « réflexion » (4). Ce dernier est dédié aux échanges sur les attentes, afin d’y déterminer s’il s’agit d’engager un travail ostéopathique ou thérapeutique. C’est principalement au sein de cet espace de réflexion que se situent les questions que nous verrons dans les illustrations cliniques, ainsi que les explications, si nécessaire, de ce qui peut se passer dans chacun des deux autres cadres (ostéopathie ou thérapie). Lorsque les attentes sont claires dès le départ, le passage y est bref, mais il peut parfois nécessiter le temps d’une séance entière. Il est alors important d’expliciter que c’est dans cet espace que nous sommes. Et puisqu’il s’agit d’un temps amenant à la prise de position, il comporte déjà des effets thérapeutiques potentiels. Je considère chaque démarrage de consultation comme une entrée, en premier lieu, dans l’espace de travail (1). Les motifs qui m’y sont présentés par les patients sont à 80 % d’ordre somatique (douleurs, troubles digestifs, fatigue, etc.), en lien avec ma base ostéopathique. Les autres motifs sont variés et proches de ceux rencontrés dans les cabinets de psychothérapie. Pour les motifs d’ordre somatique, il existe un continuum dans la représentation des causes perçues par les patients, allant d’une vision strictement « mécanique » à une perception plus « psycho-émotionnelle », avec des degrés variés de combinaison entre les deux. Et puisque cette représentation influence directement l’éventualité d’un travail plus thérapeutique, j’y porte une attention particulière dans mon écoute.
DEUX ILLUSTRATIONS CLINIQUES
1. Algoneurodystrophie Afin d’illustrer mon propos, commençons avec l’exemple de Jérôme. Ce jeune sportif de 20 ans fait partie de ces patients « partants pour tout ». Il s’est fracturé le plateau tibial en jouant au volley il y a dix-huit mois. Il a ensuite développé une algoneurodystrophie du genou gauche qui a duré quelques mois. Lorsqu’il vient me voir, il va déjà mieux et les examens médicaux sont bons, mais il décrit des douleurs résiduelles et une appréhension qui l’empêchent de courir. Il me dit aussi : « C’est bizarre, je ne le sens pas comme l’autre, il est engourdi. » Comme j’ai un léger doute sur le fait qu’il vient bien me voir en tant qu’ostéopathe, je lui demande :
- Thérapeute : « Est-ce que je peux vous demander comment vous avez eu mon nom ?
- Jérôme : C’est avec un ami, vous lui avez débloqué le dos.
- Th. : D’accord, donc il vous a parlé de moi en tant qu’ostéopathe j’imagine ?
- Jérôme : C’est ça. Par contre j’ai vu que vous faisiez aussi de l’hypnose.
- Th. : C’est vrai. Et qu’est-ce qui vous a plutôt décidé à prendre rendez-vous avec moi ? Le conseil de votre ami ? Ou que je fasse de l’hypnose ?
- Jérôme : Que vous fassiez de l’hypnose. J’ai entendu dire que ça pouvait aider pour les douleurs.
- Th. : Ah, et vous vous demandez si ça pourrait aussi vous aider ?
- Jérôme : Oui, clairement, s’il y a des chances que ça m’aide, je veux bien. Vous pensez que ça pourrait améliorer ?
- Th. : C’est une bonne question. Parfois quand certaines douleurs persistent au lieu de rentrer dans l’ordre, il y a une part émotionnelle qui peut être liée... en lien avec l’accident ou avec d’autres choses. Et ça peut faire obstacle. L’hypnose peut aider pour lever ce qui fait obstacle. (J’adopte une approche ouverte, succincte, en gardant une position de réserve quant aux résultats possibles. Ses réponses verbales et non verbales guideront notre démarche.)
- Jérôme : C’est sûr que l’accident, ce n’était pas rien pour moi, moi qui fais beaucoup de sport, ça m’a mis un coup. S’il faut travailler ça, je veux bien. (A l’entendre et à l’observer, je perçois chez lui une réelle motivation. Je m’autorise donc à proposer directement une façon de travailler ensemble.)
- Th. : D’accord. Est-ce que ça vous convient si je vous explique comment je travaille et comment on pourrait procéder ?
- Jérôme : Bien sûr.
- Th. : Comme votre ami vous a conseillé de venir me voir, je vous propose qu’on commence par une ou deux séances d’ostéopathie. En fonction de l’évolution, si des obstacles persistent, on verra s’il peut être intéressant de continuer ce travail avec l’hypnose. Qu’en dites-vous ?
- Jérôme : Ça me va très bien. »
Lire la suite...
Pierre PETILLOT
Ostéopathe et hypnothérapeute en libéral à Vannes dans le Morbihan. Formée aux thérapies brèves et à la thérapie du lien et des modes relationnels. Formateur en TLMR
Commandez ce Hors-série de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves n°19 SOMMAIRE
06 / Éditorial Troubles Psychosomatiques S’engager dans une médecine plus holistique bio-psycho-sociale J. Betbèze
10 / Avant-propos Une exploration de territoires où corps et esprit se rejoignent E. Bardot et S. Roy
12 / En couverture Anne Donzé et Vincent Chagnon S. Cohen
14 / Le pouvoir de l’eczéma Décontaminer le parent des effets du symptôme V. Bardot
28 / Psoriasis géant De la pensée opératoire à la pensée symbolique par la Thérapie du lien et des mondes relationnels (TLMR) S. Roy
40 / Psychosomatique et dermatologie : La peau, métaphore de la relation V. Bonnet
52 / Maux de tête et désir de perfection Sensations, externalisation et TLMR É. Bardot
71 / La controverse de médecine psychosomatique Entre corps et esprit, une fracture médicale et philosophique G. Ostermann
78 / Grand Entretien Jean Benjamin Stora et la psychosomatique intégrative G. Ostermann
94 / La psychosomatique, un phénomène hypnotique protecteur Sensations, émotions et PTR G. Brassine
106 / Honte et brûlures du cou Le symptôme somatique persistant M. Faucoup
120 / Ostéopathie et psychosomatique Enjeux et apports de la « double casquette ». Algoneurodystrophie et de douleurs abdominales P. Pétillot
134 / Quand la douleur devient l’identité Se relier à sa mobilité relationnelle M.-A. Jolly
146 / Trouble fonctionnel intestinal et syndrome anxiodépressif Signaux idéomoteurs et psychosomatiques S. Radoykov
152 / Asthme et créativité Les suggestions posthypnotiques de Proust P. Kivits
164 / L’hypnose thérapeutique, de quoi parle-t-on ? Un échange croisé, autour de l’hypnose thérapeutique É. Bardot, J. Betbèze et S. Roy
172 / Poême Ce corps K. Ficini
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Souffrance et créativité: Blandine ROSSI-BOUCHET pour la Revue Hypnose et Thérapies Brèves 76.
Le patient Milton Erickson sous le prisme orthophonique. Ce thérapeute hors du commun, qui a totalement révolutionné l’utilisation de l’hypnose, a surtout été un enfant puis un adolescent et un homme affligé de nombreux handicaps. Focus orthophonique sur un patient singulier : le sage de Phoenix.
L’ENFANT
Comme un synopsis de western, l’histoire débute dans le Grand Ouest et ses contrées inhospitalières. Un certain Mr Erickson, descendant d’immigrés scandinaves et originaire de Chicago, venait de quitter sa ferme du Wisconsin pour un trou perdu au fin fond du Nevada : Aurum et ses mines.
Bébé Milton y vit le jour en 1901, dans une cabane dont « trois côtés étaient en rondins, le quatrième étant la montagne ». La prospection se révélant plus délétère qu’aurifère, la famille retourna à ses racines terriennes dans le Wisconsin. C’est là que la scolarité du petit Milton mit en évidence ses troubles sensoriels et congénitaux. Il était daltonien (1) avec une dyschromatopsie au rouge et au vert ; c’était sa façon de voir jusqu’à ce qu’il remarquât certaines réactions positives de ses proches pour des couleurs neutres ou affreuses pour lui-même (seul le violet trouvait grâce à ses yeux).
Cette singularité fut certainement le début d’une autre histoire, qui occupa le reste de sa vie : la relativité de la perception. Milton était également amusique (2) et présentait une surdité aux rythmes auditifs, incapable de reconnaître une mélodie qui n’était pour lui que du bruit. Il compensa certainement cette particularité par une observation attentive des mouvements des doigts de ses soeurs sur le piano, le tempo de son rythme cardiaque, ou encore le rythme respiratoire.
Le petit Milton était surtout sévèrement dyslexique (3), raison pour laquelle il se passionna pour la langue, passant des journées entières le nez dans les dictionnaires, lui valant le surnom de « Monsieur Dictionnaire ». Son professeur essaya semble-t-il en vain plusieurs techniques pour aider son élève en difficulté. Un jour, elle écrit au tableau deux mots dont l’accolement aurait pu former le mot « gouvernement » à condition de supprimer une syllabe. Milton fixa ces deux mots et dans une sorte d’exercice d’imagerie mentale créa un pont virtuel entre les deux, une sorte d’hallucination hypnotique avec le mot « gouvernement » écrit en un seul morceau. Il venait d’expérimenter spontanément une technique de rééducation orthophonique.
En réalité, dès sa plus tendre enfance le petit Milton a cherché et surtout trouvé lui-même des solutions à chacune de ses difficultés. « Si l’ambiance de son enfance était paisible, le petit Milton n’en était pas moins handicapé, mais ces handicaps n’ont pas pour autant monopolisé la vie de famille. Que Milton soit daltonien, sourd aux rythmes musicaux et dyslexique ne semble pas avoir été traité comme une affaire d’Etat chez les Erickson », selon Dominique Megglé. De nos jours, toute la vie de la famille aurait sans nul doute été centrée sur ces soucis, reconnus comme handicaps, à tort ou à raison, par la société. Madame Erickson aurait consulté le pédiatre ou son médecin généraliste, une prescription de bilan orthophonique aurait été remise à la maman de Milton, et ce dernier aurait ensuite passé toute une batterie de tests normés et étalonnés pour s’entendre annoncer le diagnostic de dyslexie (dysorthographie associée a priori).
Des séances de rééducation (avec moult matériels et diverses techniques rééducatives plus perfectionnées les unes que les autres) auraient été mises en oeuvre par un orthophoniste pour montrer au petit patient Milton comment compenser son trouble de lecture. Ce dernier aurait ainsi bénéficié de réponses adaptées, d’une aide appropriée et n’aurait pas eu à découvrir et inventer par lui-même les nouveaux apprentissages nécessaires à la compensation de ses handicaps. Peut-être en aurait-il retiré encore plus de possibilités adaptatives, les soins orthophoniques se basant sur les ressources du patient pour révéler toutes ses potentialités compensatrices. Mais qui dit que cela n’aurait pas, au final, bridé les capacités géniales et l’inventivité induites par les handicaps qu’il lui aura bien fallu surmonter sans aucune autre aide que la sienne ?
L’ADOLESCENT
En 1919, à l’âge de 17 ans, il fut victime d’une forme grave de poliomyélite qui, après trois jours de coma, le laissa paralysé... Pendant plus d’un an, cloué durant de longues heures dans son lit puis dans un fauteuil à bascule, fort de son expérience antérieure liée à son amusie et sa dyslexie, Milton poursuivit ses expérimentations sensorielles (et hypnotiques) pour développer à l’extrême cette faculté d’observation remarquable qu’il mit au service de son « auto-rééducation ». Ses deux soeurs aînées lui enseignèrent, à leur insu, l’importance du langage non verbal, capable d’exprimer l’inverse du langage verbal. Sa plus jeune soeur, en plein apprentissage de la marche, lui permit de se remémorer ses gestes antérieurs et de les coordonner... Par la seule force de sa volonté, de sa ténacité et d’efforts acharnés, il recouvra pratiquement l’ensemble de ses capacités en moins d’un an. Si j’ose transposer cette situation une fois encore à notre réalité actuelle, Milton aurait bénéficié d’une rééducation intensive en kinésithérapie au sein d’un centre de médecine physique et de réadaptation.
Seul dans sa chambre, il aurait peu bénéficié de la présence inspirante de sa fratrie. En lieu et place, il aurait côtoyé quotidiennement d’autres patients tous plus handicapés les uns que les autres, à différents stades de leur réadaptation, chacun reproduisant les mouvements demandés par son kinésithérapeute respectif... Milton découvrit par lui-même les phénomènes de l’autohypnose thérapeutique : « Je ne pouvais même pas dire où se trouvaient mes bras et mes jambes dans mon lit. C’est ainsi que j’ai passé des heures à essayer de localiser ma main, mon pied, ou mes orteils, en guettant la moindre sensation, et je suis devenu particulièrement attentif à ce que sont les mouvements. » Avec un protocole de soin élaboré par un autre, n’ayant à observer que des patients brisés et handicapés, Milton aurait-il développé les mêmes capacités ? Se serait-il rétabli de façon aussi remarquable ?
L’ÉTUDIANT PUIS LE JEUNE MÉDECIN
De nombreuses et douloureuses séquelles physiques grevant toute possibilité pour lui de devenir agriculteur, le jeune Milton aurait pu sombrer dans la dépression, être gagné par la colère. Il aurait pu laisser le ressentiment le gagner, occuper toutes ses pensées, monopoliser toutes ses pensées... Je l’ai déjà observé chez certains patients. Il semblerait que dans la famille Erickson, le mot échec ou renoncement n’existe pas. Comme son père avait appris de ses échecs de prospecteur en changeant de vie, Milton choisit de transformer son vécu de la maladie en armes de conviction thérapeutique. Il passa de l’autre côté du stéthoscope en toute conscience : « Ensuite, quand j’ai commencé à récupérer et que j’ai pris conscience de mes handicaps, je me suis demandé comment j’allais gagner ma vie. (...) Je n’avais plus les forces requises pour être fermier, mais peut-être en aurais-je assez pour être médecin... »
Etudiant en troisième année de médecine, Milton participa au séminaire sur l’hypnose organisé par Clark Hull dans son université, qui fut le véritable déclencheur de la vocation de celui qui était déjà nommé « Monsieur Hypnose ». Refusant les procédures d’induction standardisées que souhaitait son mentor, Milton décida de mener ses propres recherches sur l’hypnose. Il continua ainsi son propre chemin en développant son empathie naturelle, sa sensibilité accrue à ressentir la souffrance de l’autre, ainsi qu’une faculté de compréhension de l’être humain dans toute sa complexité.
Quelques années plus tard, une conviction inébranlable chevillée à son corps meurtri, son doctorat en médecine ainsi qu’une maîtrise de psychologie en poche, ce médecin obstiné poursuivit sa carrière au sein de services lui interdisant la pratique de son art de prédilection. Qu’à cela ne tienne. Le défi et le contournement de la résistance étant pour ainsi dire dans ses gènes (pour preuve l’histoire du veau) (4), Milton Erickson brava l’interdiction à sa manière, tout en subtilité. Il développa envers et contre tous des techniques de communication d’allure non hypnotique très efficaces et directement inspirées de l’hypnose.
L’HOMME MÛR
Pendant la guerre, sa santé se dégrada, du fait d’allergies croissantes liées au climat humide du Michigan. En 1948, à 47 ans, des accidents allergiques gravissimes le conduisirent en réanimation. Il devait absolument partir vivre dans un climat chaud et sec pour préserver sa santé fragile. Encore une fois la vie lui jouait un sale tour, un de plus : Milton devait tout abandonner au moment où ses travaux commençaient à être célèbres et respectés... Nouveau défi en réalité ! Il s’installa dans un endroit désertique à Phoenix en Arizona, où il ouvrit un cabinet de thérapeute libéral, libéré surtout des contraintes administratives. Il démarra rapidement des consultations peu orthodoxes pour cette période d’omnipotence psychanalytique.
Le thérapeute ne devait en aucun cas se mêler de la vie sociale des patients, ni faire intervenir la sienne, ni se rendre à domicile ; il recevait toujours individuellement le client, et sa tâche était de l’aider à comprendre ce qui, dans son passé, l’avait amené aux difficultés présentes. Point final. Milton Erickson fit exactement ce qu’il voulait, ou plutôt ce qu’il pensait devoir faire dans l’intérêt de chacun de ses patients. Cette perspective thérapeutique, appelée « écosystémique » en orthophonie, l’a ainsi conduit à recevoir le couple en cas de problème conjugal, à se rendre lui-même dans la famille, ou bien à la recevoir dans son ensemble en cas de problème familial. Il fut le premier à comprendre qu’un patient ne pouvait s’expliquer en dehors de son contexte. Selon Dominique Megglé, des patients souffraient, il voulait les soulager ; rien d’autre n’avait d’importance. Plus rien ni personne ne réfrénait sa créativité.
L’HOMME RATTRAPÉ PAR LA MALADIE
En 1953, Milton Erickson subit une seconde crise de la poliomyélite qui provoqua de nouveaux déficits musculaires, aggravant encore son handicap. Il perdit l’usage des deux jambes et d’un bras. Progressivement sa voix, son instrument de travail aiguisé comme un scalpel, devint quasi inaudible, à tel point que les derniers films tournés avec lui sont sous-titrés. A notre époque Milton aurait été déclaré inapte, mis en invalidité et serait une nouvelle fois retourné en service de médecine physique et de réadaptation.
A moins qu’il n’ait préféré le libéral, la semaine s’égrainant au rythme des séances de kinésithérapie pour maintenir son autonomie physique. Milton aurait passé beaucoup de temps dans les ambulances pour bénéficier en outre de séances d’orthophonie visant à lui permettre de limiter les conséquences de sa dysarthrie et de son hypophonie.
Ces soins chronophages et énergivores lui auraient-ils laissé l’opportunité de poursuivre son travail en simplifiant davantage ses techniques afin de produire le maximum d’effet avec l’intervention la plus minime ? Les soins orthophoniques auraient-ils amélioré la communication non verbale de cet homme cloué dans sa chaise roulante ? Est-il possible de faire émerger chez un patient hypophonique, qui ne l’a jamais expérimenté auparavant, toute une diversité d’expressions du regard ou de la mimique, passant successivement de l’espièglerie à la vivacité, la fermeté, la douleur, puis la détente ou autres multiples indications hypnotiques ? J’en doute. FIN DE (SA) VIE Les dix dernières années de sa vie, Milton Erickson était perclus de douleurs. Tout effort prolongé lui était physiquement insupportable, malgré l’autohypnose.
Pour lire la suite...
NOTES
1. Le daltonisme (ou dyschromatopsie) est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs d’origine généralement génétique.
2. L’amusie est une anomalie neurologique dans laquelle le rythme, la mélodie et les accords de musique ne sont pas perçus ou n’ont pas de sens pour une personne d’audition par ailleurs normale. L’amusie peut être congénitale ou résulter d’une lésion cérébrale.
3. La dyslexie est un trouble du neurodéveloppement impactant la lecture, qui est reconnue comme un « trouble spécifique de l’apprentissage » ou TSA, et objet de soins orthophoniques pour permettre à l’enfant ou l’adolescent de dépasser ou compenser ce trouble. La dyslexie s’accompagne parfois de dysorthographie, qui concerne l’orthographe.
4. « Un jour, son père tente de faire rentrer un veau dans l’étable en le tirant par le licol. Plus il le tire vers l’étable, plus l’animal fait pile. Milton observe la scène et la trouve très drôle : son père suant et criant, la bête placide et immobile. Le rire sans retenue de Milton exaspère papa qui, furieux, finit par lui dire : “Eh bien, vas-y puisque tu es si fort, fais le rentrer dans l’étable !” Mis au défi, l’enfant réfléchit un bref instant, puis alors que son père continue à tirer le veau vers l’étable, prend la queue de celui-ci et se met à tirer de toutes ses forces dessus, en sens contraire, comme pour l’éloigner de l’étable. L’animal y rentre aussitôt bien sagement. Leçon de l’histoire, qu’Erickson racontera souvent : quand on doit résister à deux forces, on choisit toujours de résister à la plus faible ; la prétendue “résistance” au changement est une force à utiliser, non à combattre, et la meilleure alliée au service de ce changement » (Dominique Megglé, p. 21).
BIBLIOGRAPHIE
- Erickson M.H., Rossi E.L., Rossi S.I., « Traité pratique de l’hypnose, la suggestion indirecte en hypnose clinique », Grancher, Esclaquens, février 2006.
- Erickson M.H., « L’hypnose thérapeutique, quatre conférences », ESF Editeur, Clamecy, février 2018.
- Halay J., « Un thérapeute hors du commun, Milton H. Erickson », Desclée de Brouwer, Langres, octobre 2013.
- Megglé D., « Erickson, hypnose et psychothérapie », Retz, Paris, 2005, 3e édition.
Blandine Rossi-Bouchet dit Layuyouse Orthophoniste, autrice (ouvrage Douleur en pratique orthophonique),
enseignante au CFUO (Centre de formation universitaire en orthophonie) de Bordeaux, ainsi qu’au DIU Hypnose de Bordeaux où elle a été formée.
Elle est responsable Formation et éthique de l’association Hypnose33-Ecole bordelaise ericksonienne et a animé une Masterclass lors du 13e Forum de la CFHTB qui a eu lieu du 15 au 18 mai 2024 à Bordeaux, ainsi que 2 communications orales:
* Autohypnose: Question de Pratique & Pratique en Question.
* Hypnose en pratique orthophonique (HypnoPhonie®).
Elle est Membre de France EMDR - IMO.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°76 version Papier N°76 : Fév. / Mars / Avril 2025
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
. Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Livres en bouche
Illustrations de Caroline Berthet
Comme un synopsis de western, l’histoire débute dans le Grand Ouest et ses contrées inhospitalières. Un certain Mr Erickson, descendant d’immigrés scandinaves et originaire de Chicago, venait de quitter sa ferme du Wisconsin pour un trou perdu au fin fond du Nevada : Aurum et ses mines.
Bébé Milton y vit le jour en 1901, dans une cabane dont « trois côtés étaient en rondins, le quatrième étant la montagne ». La prospection se révélant plus délétère qu’aurifère, la famille retourna à ses racines terriennes dans le Wisconsin. C’est là que la scolarité du petit Milton mit en évidence ses troubles sensoriels et congénitaux. Il était daltonien (1) avec une dyschromatopsie au rouge et au vert ; c’était sa façon de voir jusqu’à ce qu’il remarquât certaines réactions positives de ses proches pour des couleurs neutres ou affreuses pour lui-même (seul le violet trouvait grâce à ses yeux).
Cette singularité fut certainement le début d’une autre histoire, qui occupa le reste de sa vie : la relativité de la perception. Milton était également amusique (2) et présentait une surdité aux rythmes auditifs, incapable de reconnaître une mélodie qui n’était pour lui que du bruit. Il compensa certainement cette particularité par une observation attentive des mouvements des doigts de ses soeurs sur le piano, le tempo de son rythme cardiaque, ou encore le rythme respiratoire.
Le petit Milton était surtout sévèrement dyslexique (3), raison pour laquelle il se passionna pour la langue, passant des journées entières le nez dans les dictionnaires, lui valant le surnom de « Monsieur Dictionnaire ». Son professeur essaya semble-t-il en vain plusieurs techniques pour aider son élève en difficulté. Un jour, elle écrit au tableau deux mots dont l’accolement aurait pu former le mot « gouvernement » à condition de supprimer une syllabe. Milton fixa ces deux mots et dans une sorte d’exercice d’imagerie mentale créa un pont virtuel entre les deux, une sorte d’hallucination hypnotique avec le mot « gouvernement » écrit en un seul morceau. Il venait d’expérimenter spontanément une technique de rééducation orthophonique.
En réalité, dès sa plus tendre enfance le petit Milton a cherché et surtout trouvé lui-même des solutions à chacune de ses difficultés. « Si l’ambiance de son enfance était paisible, le petit Milton n’en était pas moins handicapé, mais ces handicaps n’ont pas pour autant monopolisé la vie de famille. Que Milton soit daltonien, sourd aux rythmes musicaux et dyslexique ne semble pas avoir été traité comme une affaire d’Etat chez les Erickson », selon Dominique Megglé. De nos jours, toute la vie de la famille aurait sans nul doute été centrée sur ces soucis, reconnus comme handicaps, à tort ou à raison, par la société. Madame Erickson aurait consulté le pédiatre ou son médecin généraliste, une prescription de bilan orthophonique aurait été remise à la maman de Milton, et ce dernier aurait ensuite passé toute une batterie de tests normés et étalonnés pour s’entendre annoncer le diagnostic de dyslexie (dysorthographie associée a priori).
Des séances de rééducation (avec moult matériels et diverses techniques rééducatives plus perfectionnées les unes que les autres) auraient été mises en oeuvre par un orthophoniste pour montrer au petit patient Milton comment compenser son trouble de lecture. Ce dernier aurait ainsi bénéficié de réponses adaptées, d’une aide appropriée et n’aurait pas eu à découvrir et inventer par lui-même les nouveaux apprentissages nécessaires à la compensation de ses handicaps. Peut-être en aurait-il retiré encore plus de possibilités adaptatives, les soins orthophoniques se basant sur les ressources du patient pour révéler toutes ses potentialités compensatrices. Mais qui dit que cela n’aurait pas, au final, bridé les capacités géniales et l’inventivité induites par les handicaps qu’il lui aura bien fallu surmonter sans aucune autre aide que la sienne ?
L’ADOLESCENT
En 1919, à l’âge de 17 ans, il fut victime d’une forme grave de poliomyélite qui, après trois jours de coma, le laissa paralysé... Pendant plus d’un an, cloué durant de longues heures dans son lit puis dans un fauteuil à bascule, fort de son expérience antérieure liée à son amusie et sa dyslexie, Milton poursuivit ses expérimentations sensorielles (et hypnotiques) pour développer à l’extrême cette faculté d’observation remarquable qu’il mit au service de son « auto-rééducation ». Ses deux soeurs aînées lui enseignèrent, à leur insu, l’importance du langage non verbal, capable d’exprimer l’inverse du langage verbal. Sa plus jeune soeur, en plein apprentissage de la marche, lui permit de se remémorer ses gestes antérieurs et de les coordonner... Par la seule force de sa volonté, de sa ténacité et d’efforts acharnés, il recouvra pratiquement l’ensemble de ses capacités en moins d’un an. Si j’ose transposer cette situation une fois encore à notre réalité actuelle, Milton aurait bénéficié d’une rééducation intensive en kinésithérapie au sein d’un centre de médecine physique et de réadaptation.
Seul dans sa chambre, il aurait peu bénéficié de la présence inspirante de sa fratrie. En lieu et place, il aurait côtoyé quotidiennement d’autres patients tous plus handicapés les uns que les autres, à différents stades de leur réadaptation, chacun reproduisant les mouvements demandés par son kinésithérapeute respectif... Milton découvrit par lui-même les phénomènes de l’autohypnose thérapeutique : « Je ne pouvais même pas dire où se trouvaient mes bras et mes jambes dans mon lit. C’est ainsi que j’ai passé des heures à essayer de localiser ma main, mon pied, ou mes orteils, en guettant la moindre sensation, et je suis devenu particulièrement attentif à ce que sont les mouvements. » Avec un protocole de soin élaboré par un autre, n’ayant à observer que des patients brisés et handicapés, Milton aurait-il développé les mêmes capacités ? Se serait-il rétabli de façon aussi remarquable ?
L’ÉTUDIANT PUIS LE JEUNE MÉDECIN
De nombreuses et douloureuses séquelles physiques grevant toute possibilité pour lui de devenir agriculteur, le jeune Milton aurait pu sombrer dans la dépression, être gagné par la colère. Il aurait pu laisser le ressentiment le gagner, occuper toutes ses pensées, monopoliser toutes ses pensées... Je l’ai déjà observé chez certains patients. Il semblerait que dans la famille Erickson, le mot échec ou renoncement n’existe pas. Comme son père avait appris de ses échecs de prospecteur en changeant de vie, Milton choisit de transformer son vécu de la maladie en armes de conviction thérapeutique. Il passa de l’autre côté du stéthoscope en toute conscience : « Ensuite, quand j’ai commencé à récupérer et que j’ai pris conscience de mes handicaps, je me suis demandé comment j’allais gagner ma vie. (...) Je n’avais plus les forces requises pour être fermier, mais peut-être en aurais-je assez pour être médecin... »
Etudiant en troisième année de médecine, Milton participa au séminaire sur l’hypnose organisé par Clark Hull dans son université, qui fut le véritable déclencheur de la vocation de celui qui était déjà nommé « Monsieur Hypnose ». Refusant les procédures d’induction standardisées que souhaitait son mentor, Milton décida de mener ses propres recherches sur l’hypnose. Il continua ainsi son propre chemin en développant son empathie naturelle, sa sensibilité accrue à ressentir la souffrance de l’autre, ainsi qu’une faculté de compréhension de l’être humain dans toute sa complexité.
Quelques années plus tard, une conviction inébranlable chevillée à son corps meurtri, son doctorat en médecine ainsi qu’une maîtrise de psychologie en poche, ce médecin obstiné poursuivit sa carrière au sein de services lui interdisant la pratique de son art de prédilection. Qu’à cela ne tienne. Le défi et le contournement de la résistance étant pour ainsi dire dans ses gènes (pour preuve l’histoire du veau) (4), Milton Erickson brava l’interdiction à sa manière, tout en subtilité. Il développa envers et contre tous des techniques de communication d’allure non hypnotique très efficaces et directement inspirées de l’hypnose.
L’HOMME MÛR
Pendant la guerre, sa santé se dégrada, du fait d’allergies croissantes liées au climat humide du Michigan. En 1948, à 47 ans, des accidents allergiques gravissimes le conduisirent en réanimation. Il devait absolument partir vivre dans un climat chaud et sec pour préserver sa santé fragile. Encore une fois la vie lui jouait un sale tour, un de plus : Milton devait tout abandonner au moment où ses travaux commençaient à être célèbres et respectés... Nouveau défi en réalité ! Il s’installa dans un endroit désertique à Phoenix en Arizona, où il ouvrit un cabinet de thérapeute libéral, libéré surtout des contraintes administratives. Il démarra rapidement des consultations peu orthodoxes pour cette période d’omnipotence psychanalytique.
Le thérapeute ne devait en aucun cas se mêler de la vie sociale des patients, ni faire intervenir la sienne, ni se rendre à domicile ; il recevait toujours individuellement le client, et sa tâche était de l’aider à comprendre ce qui, dans son passé, l’avait amené aux difficultés présentes. Point final. Milton Erickson fit exactement ce qu’il voulait, ou plutôt ce qu’il pensait devoir faire dans l’intérêt de chacun de ses patients. Cette perspective thérapeutique, appelée « écosystémique » en orthophonie, l’a ainsi conduit à recevoir le couple en cas de problème conjugal, à se rendre lui-même dans la famille, ou bien à la recevoir dans son ensemble en cas de problème familial. Il fut le premier à comprendre qu’un patient ne pouvait s’expliquer en dehors de son contexte. Selon Dominique Megglé, des patients souffraient, il voulait les soulager ; rien d’autre n’avait d’importance. Plus rien ni personne ne réfrénait sa créativité.
L’HOMME RATTRAPÉ PAR LA MALADIE
En 1953, Milton Erickson subit une seconde crise de la poliomyélite qui provoqua de nouveaux déficits musculaires, aggravant encore son handicap. Il perdit l’usage des deux jambes et d’un bras. Progressivement sa voix, son instrument de travail aiguisé comme un scalpel, devint quasi inaudible, à tel point que les derniers films tournés avec lui sont sous-titrés. A notre époque Milton aurait été déclaré inapte, mis en invalidité et serait une nouvelle fois retourné en service de médecine physique et de réadaptation.
A moins qu’il n’ait préféré le libéral, la semaine s’égrainant au rythme des séances de kinésithérapie pour maintenir son autonomie physique. Milton aurait passé beaucoup de temps dans les ambulances pour bénéficier en outre de séances d’orthophonie visant à lui permettre de limiter les conséquences de sa dysarthrie et de son hypophonie.
Ces soins chronophages et énergivores lui auraient-ils laissé l’opportunité de poursuivre son travail en simplifiant davantage ses techniques afin de produire le maximum d’effet avec l’intervention la plus minime ? Les soins orthophoniques auraient-ils amélioré la communication non verbale de cet homme cloué dans sa chaise roulante ? Est-il possible de faire émerger chez un patient hypophonique, qui ne l’a jamais expérimenté auparavant, toute une diversité d’expressions du regard ou de la mimique, passant successivement de l’espièglerie à la vivacité, la fermeté, la douleur, puis la détente ou autres multiples indications hypnotiques ? J’en doute. FIN DE (SA) VIE Les dix dernières années de sa vie, Milton Erickson était perclus de douleurs. Tout effort prolongé lui était physiquement insupportable, malgré l’autohypnose.
Pour lire la suite...
NOTES
1. Le daltonisme (ou dyschromatopsie) est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs d’origine généralement génétique.
2. L’amusie est une anomalie neurologique dans laquelle le rythme, la mélodie et les accords de musique ne sont pas perçus ou n’ont pas de sens pour une personne d’audition par ailleurs normale. L’amusie peut être congénitale ou résulter d’une lésion cérébrale.
3. La dyslexie est un trouble du neurodéveloppement impactant la lecture, qui est reconnue comme un « trouble spécifique de l’apprentissage » ou TSA, et objet de soins orthophoniques pour permettre à l’enfant ou l’adolescent de dépasser ou compenser ce trouble. La dyslexie s’accompagne parfois de dysorthographie, qui concerne l’orthographe.
4. « Un jour, son père tente de faire rentrer un veau dans l’étable en le tirant par le licol. Plus il le tire vers l’étable, plus l’animal fait pile. Milton observe la scène et la trouve très drôle : son père suant et criant, la bête placide et immobile. Le rire sans retenue de Milton exaspère papa qui, furieux, finit par lui dire : “Eh bien, vas-y puisque tu es si fort, fais le rentrer dans l’étable !” Mis au défi, l’enfant réfléchit un bref instant, puis alors que son père continue à tirer le veau vers l’étable, prend la queue de celui-ci et se met à tirer de toutes ses forces dessus, en sens contraire, comme pour l’éloigner de l’étable. L’animal y rentre aussitôt bien sagement. Leçon de l’histoire, qu’Erickson racontera souvent : quand on doit résister à deux forces, on choisit toujours de résister à la plus faible ; la prétendue “résistance” au changement est une force à utiliser, non à combattre, et la meilleure alliée au service de ce changement » (Dominique Megglé, p. 21).
BIBLIOGRAPHIE
- Erickson M.H., Rossi E.L., Rossi S.I., « Traité pratique de l’hypnose, la suggestion indirecte en hypnose clinique », Grancher, Esclaquens, février 2006.
- Erickson M.H., « L’hypnose thérapeutique, quatre conférences », ESF Editeur, Clamecy, février 2018.
- Halay J., « Un thérapeute hors du commun, Milton H. Erickson », Desclée de Brouwer, Langres, octobre 2013.
- Megglé D., « Erickson, hypnose et psychothérapie », Retz, Paris, 2005, 3e édition.
Blandine Rossi-Bouchet dit Layuyouse Orthophoniste, autrice (ouvrage Douleur en pratique orthophonique),
enseignante au CFUO (Centre de formation universitaire en orthophonie) de Bordeaux, ainsi qu’au DIU Hypnose de Bordeaux où elle a été formée.
Elle est responsable Formation et éthique de l’association Hypnose33-Ecole bordelaise ericksonienne et a animé une Masterclass lors du 13e Forum de la CFHTB qui a eu lieu du 15 au 18 mai 2024 à Bordeaux, ainsi que 2 communications orales:
* Autohypnose: Question de Pratique & Pratique en Question.
* Hypnose en pratique orthophonique (HypnoPhonie®).
Elle est Membre de France EMDR - IMO.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°76 version Papier N°76 : Fév. / Mars / Avril 2025
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
. Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Livres en bouche
Illustrations de Caroline Berthet
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Scoliose et hypnose.
Retrouver enfin le premier rôle dans le film de ta vie. Rachel REY pour la Revue Hypnose et Thérapies Brèves 76.
SPH... Trois lettres pour désigner un travail mené avec les suggestions post-hypnotiques, réalisé ici sur une patiente de 16 ans en attente d’une opération de chirurgie orthopédique. L’objectif : apaiser une forte anxiété, préparer aux différentes étapes de l’opération, recadrer la douleur, insuffler du confort et de la détente pour mieux aborder la voie de la guérison.
Depuis longtemps, tu es obligé de porter un corset, qui entrave tes mouvements et limite tes actions. « C’est pour ton bien ! », te répète-t-on. Les consultations et les examens radiologiques se succèdent années après années, tout au long de ta croissance. De praticiens en praticiens, de consultations en consultations, tu es guidé. Et puis un jour, on t’explique que tu dois être opéré de cette scoliose idiopathique devenue trop importante. Que l’on va mettre en place des implants métalliques le long de ta colonne vertébrale afin de la redresser. Depuis ton plus jeune âge tu as suivi et respecté les consignes et aujourd’hui tu es face à cette nécessité, avec toute l’angoisse que cela comporte.
Comment te redonner la possibilité de retrouver enfin le premier rôle dans le film de ta vie ? Proposer aux parents et aux enfants une préparation par l’hypnose en amont de cette chirurgie lourde, invalidante, douloureuse et très anxiogène. Du port du corset thoracique, en passant par une préparation spécifique dans un établissement de rééducation. Un long travail en kinésithérapie est imposé aux enfants, extensions sur des brancards de traction, exercices respiratoires destinés à améliorer le recrutement pulmonaire, apprentissage des techniques de mobilisation en bloc pour faciliter les levers et permettre de réaliser les gestes de la vie quotidienne en épargnant la colonne vertébrale.
Avec bien évidemment un suivi post-opératoire tout aussi pesant, qui nécessite plusieurs jours en réanimation afin de gérer la douleur, les nausées, les vomissements, la reprise du transit, les pansements chirurgicaux et les mobilisations jusqu’au premier lever, suivi d’un séjour en service de chirurgie pour finir par le retour en service de rééducation fonctionnelle.
OBJECTIF DE TRAVAIL ET TECHNIQUES D’HYPNOANALGÉSIE.
L’objectif de cet accompagnement hypnotique est multiple. Il vise à réduire l’anxiété préopératoire, à recadrer et agir sur la douleur, à redonner un sentiment de contrôle au patient et enfin à favoriser une réhabilitation précoce. Le protocole propose deux séances d’hypnose en préopératoire à une semaine d’intervalle, ce qui permet de laisser émerger les demandes, les remarques éventuelles des enfants ou des parents. La première séance consiste à établir la relation de confiance indispensable à toute prise en charge.
Démystifier l’hypnose, expliquer comment on se prépare et surtout pourquoi cela a un ressenti positif. Répondre aux interrogations, reformuler, recadrer, obtenir un « yes set », délivrer les autorisations et accompagner l’enfant dans la recherche de son souvenir agréable ou de son lieu sécure actif. Puis le guider vers une transe, valider un signaling et enfin réaliser un ancrage. Suit le débriefing de la séance, une prescription de tâche, autohypnose et pour finir la prise de rendez-vous pour la semaine qui suit. Evocation de la séance prochaine avec l’anticipation agréablement surprenante du jour J. La deuxième séance consiste à évoquer la tâche. A-t-elle été réalisée ? Si non, qu’a fait l’enfant de plus utile pour lui ? Puis proposer à l’enfant de se mettre en autohypnose avec son geste en l’accompagnant pour s’assurer de la qualité de l’ancrage. Retrouver le lieu sécure actif, permettre une double dissociation avec une anticipation au jour de la chirurgie. Le travail de suggestion est axé sur la prémédication, le relâchement musculaire, le contrôle du saignement, la cicatrisation et le recadrage de la douleur. Enfin, un soin est porté sur les suggestions concernant la prise en charge en réanimation avec l’évocation d’une facilité pour l’élimination, la réalimentation, le confort, la détente et une réhabilitation rapide. Comme lors de la séance précédente, on réalise un débriefing, on répond aux questions et on se donne rendez-vous pour le jour libérateur.
CAS CLINIQUE
Présentation C. a 16 ans et doit bénéficier d’une ostéosynthèse du rachis. On note dans les antécédents chirurgicaux, à l’âge de 9 ans, une fracture des deux os de l’avant-bras lors d’une chute en quad qui a nécessité une intervention au bloc opératoire. Lors du réveil, C. présente une agitation très importante, des nausées et vomissements post-opératoires (NVPO). Il est noté un contexte d’anxiété très important chez C. et ses parents. Le chirurgien orthopédique propose donc à C. et sa famille un accompagnement par l’hypnose en vue de sa chirurgie future.
Chacun adhère favorablement à cette proposition. La maman me contacte pour la prise de rendez-vous. Elle me dit être très soulagée de cette prise en charge. L’échange téléphonique est très cordial. Première séance Je rencontre C. et sa maman au centre de rééducation. Nous nous installons dans une salle avec des fauteuils et des tapis. Je demande à C. où elle souhaite s’installer ? Elle choisit un fauteuil, j’invite la maman à s’asseoir sur celui de son choix et enfin je me positionne sur le dernier fauteuil. Je leur demande si elles ont déjà entendu parler de l’hypnose et si elles en ont déjà bénéficié. C. me parle de spectacle. J’assure un recadrage. J’explique ce qu’est l’hypnose médicale et comment ça marche. M’adressant à C. : « Lorsque tu es en cours, il t’arrive d’avoir la tête ailleurs, ton prof parle et pourtant, tout en étant là, tes pensées sont ailleurs » (signe de tête affirmatif).
« Vous Madame, en rentrant à la maison en voiture, ne vous êtes-vous jamais surprise à ne plus vous souvenir d’avoir déjà passé ce feu ? (sourire et signe de la tête). C’est un phénomène dissociatif naturel qui se produit plusieurs fois au cours d’une journée, c’est normal et c’est ce phénomène que j’utilise avec l’hypnose. » M’adressant à C. : « En fait, tu sais déjà parfaitement le faire et je vais juste te donner quelques techniques pour que tu puisses utiliser cette capacité que tu as afin d’aider Emilie (c’est le prénom de la chirurgienne avec laquelle elle s’entend très bien) ». Mise en place de l’alliance thérapeutique. Je m’assure qu’elle est bien d’accord pour faire une expérience qui va l’aider à faciliter les gestes du chirurgien. Je n’utilise pas le terme « exercice », car la journée de l’enfant est déjà rythmée par les exercices de kinésithérapie et je ne souhaite pas en rajouter.
Au cours de notre échange, je valide une suite de oui « yes set ». En accord avec C., je propose à la maman de rester pour la séance si elle le souhaite. Je recherche les centres d’intérêt, j’évoque un endroit sécure, un souvenir agréable, les vacances, le sport... C. choisit un circuit moto, car c’est une passion familiale. J’explique que je vais l’accompagner dans cet endroit, et lorsqu’elle s’y trouvera, elle me le fera savoir par un signe de tête ou de doigt (signaling).
Puis je lui demande de choisir un geste, croiser les doigts par exemple, afin de retrouver très facilement ce lieu et les sensations de bien-être, de confort pré-supposé. Je les invite toutes deux à s’installer le plus confortablement possible et je délivre toutes les autorisations, bouger, parler, ouvrir ou fermer les yeux... se sentir libre de faire ce qu’elles veulent. Entendre ou non les bruits qui nous entourent, écouter ma voix (inclusion)... J’obtiens une succession de « oui » qui me permet de valider le « yes set » avant de débuter la séance. Je m’assure qu’elles sont toutes deux confortablement installées. J’utilise une induction respiratoire pour favoriser l’induction d’anesthésie au masque.
Ayant travaillé la respiration avec la kinésithérapeute, C. se sent parfaitement à l’aise, je la félicite, elle sait parfaitement faire les choses... Simplement laisser l’air pénétrer par le nez ou par la bouche sans rien changer, puis en suivre le trajet sans effort, simplement... Approfondissement avec le body scanner : prêter attention aux points d’appui, différence entre la jambe droite... la jambe gauche... ressentir une lourdeur, une légèreté ou tout autre chose, position des bras (confusion). Un relâchement dans les mollets, les cuisses, les épaules, les bras, les muscles de la nuque, du visage, les muscles autour des yeux, avec des mouvements derrière l’écran des paupières fermées (C. a fermé les yeux), puis retour à la respiration pour se rendre compte comme la respiration est devenue encore plus calme, plus confortable, et comme le ventre accompagne la respiration tranquillement, calmement... Profiter de cette respiration pour souffler ce qui n’est plus utile, ce dont elle n’a plus besoin. Emprunter le chemin de son choix avec évocation du VAKOG et apercevoir une porte qu’elle imagine comme elle le souhaite... couleur... matériaux... taille décoration... Enfin, ouvrir cette porte pour entrer dans son endroit de sécurité. Je l’invite à s’installer encore plus confortablement... reprise du body scanner... appuis sur... moto (VAKOG)... les voix, les odeurs, les moteurs... se sentir calme, paisible, tranquille, profiter de ce moment... Je constate les signes de transe au niveau des muscles du visage, des mouvements oculaires, un relâchement des épaules (ratification et félicitations). Je m’assure que C. est bien dans cet endroit où elle se sent bien par un signaling, elle me fait oui de la tête, alors je lui demande de faire son geste (ancrage). Elle croise les doigts... Validation, félicitations.
- Suggestions post-hypnotiques (SPH) : elle retrouvera le confort de cet endroit, sans effort, simplement en faisant ce geste, en fermant les yeux et en laissant la respiration respirer comme elle respire... Elle peut utiliser ce geste chaque fois qu’elle en ressent le besoin, très simplement. Elle peut profiter de ce moment et garder cet état de détente pour les heures, les jours, les semaines qui viennent. Elle peut prendre ce qui est utile pour elle et laisser ce dont elle n’a plus besoin en sachant qu’elle peut toujours le retrouver si elle le souhaite, en laissant l’inconscient se souvenir de ce qui est nécessaire, afin que les choses se passent simplement comme elles doivent se passer. Apprécier le relâchement musculaire, le dos est très relâché, confortable, parfaitement détendu... Le corps sait très bien faire cela. Métaphore de la poupée de chiffon.
- Retour : lorsque tu auras assez profité, lorsque tu auras pris ce qui est utile pour toi et ce dont tu as besoin, tu peux reprendre le chemin, à ton rythme, et revenir dans cette pièce au centre de rééducation.
- Débriefing : sur le ressenti de la séance, si certaines choses ont dérangé, ou si elles souhaitent me faire part de quoi que ce soit. La maman me dit être bien détendue, mais ne pas avoir fait ce que j’ai suggéré. Je lui dis que c’est très bien et qu’elle a certainement fait ce qui était utile pour elle à ce moment précis. C. qui me sourit : « Ouah ! c’est ouf votre truc ! C’est trop bien, je ne voulais pas revenir ! » Je demande à C. si elle a réussi à aller dans son endroit. Elle confirme que oui. Je lui demande si elle a des questions ou des remarques sur cette expérience, s’il y a des choses qui l’ont gênée ou qu’elle souhaite faire différemment la prochaine fois. Je lui précise que c’est important de me le dire pour qu’on puisse être encore plus efficaces toutes les deux la séance prochaine. Elle me précise ne rien vouloir changer. Je vérifie que toutes deux sont d’accord pour bénéficier d’une seconde séance d’hypnose. Tout le monde est volontaire, alors je propose à C. de faire quelque chose qui va être très utile pour elle, pour la chirurgie et pour Emilie la chirurgienne qui va l’opérer.
- Prescription de tâches : je demande à C., jusqu’à notre prochaine rencontre, de réaliser chaque jour au moment de son choix, lorsqu’elle est confortablement installée, le geste qu’elle a choisi et laisser simplement revenir les sensations en fermant les yeux, en se concentrant sur sa respiration et en sentant la position de son corps comme on vient de le faire. Je compare l’autohypnose à la moto : « plus on en fait et plus ça devient simple ». Un rendez-vous est convenu avec C. et sa maman pour la semaine suivante. Je dis à C. que notre prochaine séance sera une révision de sa chirurgie, un peu comme on révise une leçon avant un examen et qu’on sait qu’on est parfaitement prêt et rassuré. « Tu es OK avec ça ? » Comme C. est d’accord, je lui propose…
Rachel Rey Infirmière anesthésiste en pédiatrie au CHU de Nancy depuis 2004. Accompagne les enfants avec l’hypnose en pré, per et post-opératoire. Intervenante à l’école d’IADE pour la prise en charge du nourrisson et de l’enfant. Diplôme universitaire des Techniques d’épuration extrarénale à Strasbourg. Formation hypnose médicale et hypnoanalgésie à l’IFH, hypnose et thérapies brèves à l’Institut UTHyL à Nancy.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°76 version Papier N°76 : Fév. / Mars / Avril 2025
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
. Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Livres en bouche
Illustrations de Caroline Berthet
Depuis longtemps, tu es obligé de porter un corset, qui entrave tes mouvements et limite tes actions. « C’est pour ton bien ! », te répète-t-on. Les consultations et les examens radiologiques se succèdent années après années, tout au long de ta croissance. De praticiens en praticiens, de consultations en consultations, tu es guidé. Et puis un jour, on t’explique que tu dois être opéré de cette scoliose idiopathique devenue trop importante. Que l’on va mettre en place des implants métalliques le long de ta colonne vertébrale afin de la redresser. Depuis ton plus jeune âge tu as suivi et respecté les consignes et aujourd’hui tu es face à cette nécessité, avec toute l’angoisse que cela comporte.
Comment te redonner la possibilité de retrouver enfin le premier rôle dans le film de ta vie ? Proposer aux parents et aux enfants une préparation par l’hypnose en amont de cette chirurgie lourde, invalidante, douloureuse et très anxiogène. Du port du corset thoracique, en passant par une préparation spécifique dans un établissement de rééducation. Un long travail en kinésithérapie est imposé aux enfants, extensions sur des brancards de traction, exercices respiratoires destinés à améliorer le recrutement pulmonaire, apprentissage des techniques de mobilisation en bloc pour faciliter les levers et permettre de réaliser les gestes de la vie quotidienne en épargnant la colonne vertébrale.
Avec bien évidemment un suivi post-opératoire tout aussi pesant, qui nécessite plusieurs jours en réanimation afin de gérer la douleur, les nausées, les vomissements, la reprise du transit, les pansements chirurgicaux et les mobilisations jusqu’au premier lever, suivi d’un séjour en service de chirurgie pour finir par le retour en service de rééducation fonctionnelle.
OBJECTIF DE TRAVAIL ET TECHNIQUES D’HYPNOANALGÉSIE.
L’objectif de cet accompagnement hypnotique est multiple. Il vise à réduire l’anxiété préopératoire, à recadrer et agir sur la douleur, à redonner un sentiment de contrôle au patient et enfin à favoriser une réhabilitation précoce. Le protocole propose deux séances d’hypnose en préopératoire à une semaine d’intervalle, ce qui permet de laisser émerger les demandes, les remarques éventuelles des enfants ou des parents. La première séance consiste à établir la relation de confiance indispensable à toute prise en charge.
Démystifier l’hypnose, expliquer comment on se prépare et surtout pourquoi cela a un ressenti positif. Répondre aux interrogations, reformuler, recadrer, obtenir un « yes set », délivrer les autorisations et accompagner l’enfant dans la recherche de son souvenir agréable ou de son lieu sécure actif. Puis le guider vers une transe, valider un signaling et enfin réaliser un ancrage. Suit le débriefing de la séance, une prescription de tâche, autohypnose et pour finir la prise de rendez-vous pour la semaine qui suit. Evocation de la séance prochaine avec l’anticipation agréablement surprenante du jour J. La deuxième séance consiste à évoquer la tâche. A-t-elle été réalisée ? Si non, qu’a fait l’enfant de plus utile pour lui ? Puis proposer à l’enfant de se mettre en autohypnose avec son geste en l’accompagnant pour s’assurer de la qualité de l’ancrage. Retrouver le lieu sécure actif, permettre une double dissociation avec une anticipation au jour de la chirurgie. Le travail de suggestion est axé sur la prémédication, le relâchement musculaire, le contrôle du saignement, la cicatrisation et le recadrage de la douleur. Enfin, un soin est porté sur les suggestions concernant la prise en charge en réanimation avec l’évocation d’une facilité pour l’élimination, la réalimentation, le confort, la détente et une réhabilitation rapide. Comme lors de la séance précédente, on réalise un débriefing, on répond aux questions et on se donne rendez-vous pour le jour libérateur.
CAS CLINIQUE
Présentation C. a 16 ans et doit bénéficier d’une ostéosynthèse du rachis. On note dans les antécédents chirurgicaux, à l’âge de 9 ans, une fracture des deux os de l’avant-bras lors d’une chute en quad qui a nécessité une intervention au bloc opératoire. Lors du réveil, C. présente une agitation très importante, des nausées et vomissements post-opératoires (NVPO). Il est noté un contexte d’anxiété très important chez C. et ses parents. Le chirurgien orthopédique propose donc à C. et sa famille un accompagnement par l’hypnose en vue de sa chirurgie future.
Chacun adhère favorablement à cette proposition. La maman me contacte pour la prise de rendez-vous. Elle me dit être très soulagée de cette prise en charge. L’échange téléphonique est très cordial. Première séance Je rencontre C. et sa maman au centre de rééducation. Nous nous installons dans une salle avec des fauteuils et des tapis. Je demande à C. où elle souhaite s’installer ? Elle choisit un fauteuil, j’invite la maman à s’asseoir sur celui de son choix et enfin je me positionne sur le dernier fauteuil. Je leur demande si elles ont déjà entendu parler de l’hypnose et si elles en ont déjà bénéficié. C. me parle de spectacle. J’assure un recadrage. J’explique ce qu’est l’hypnose médicale et comment ça marche. M’adressant à C. : « Lorsque tu es en cours, il t’arrive d’avoir la tête ailleurs, ton prof parle et pourtant, tout en étant là, tes pensées sont ailleurs » (signe de tête affirmatif).
« Vous Madame, en rentrant à la maison en voiture, ne vous êtes-vous jamais surprise à ne plus vous souvenir d’avoir déjà passé ce feu ? (sourire et signe de la tête). C’est un phénomène dissociatif naturel qui se produit plusieurs fois au cours d’une journée, c’est normal et c’est ce phénomène que j’utilise avec l’hypnose. » M’adressant à C. : « En fait, tu sais déjà parfaitement le faire et je vais juste te donner quelques techniques pour que tu puisses utiliser cette capacité que tu as afin d’aider Emilie (c’est le prénom de la chirurgienne avec laquelle elle s’entend très bien) ». Mise en place de l’alliance thérapeutique. Je m’assure qu’elle est bien d’accord pour faire une expérience qui va l’aider à faciliter les gestes du chirurgien. Je n’utilise pas le terme « exercice », car la journée de l’enfant est déjà rythmée par les exercices de kinésithérapie et je ne souhaite pas en rajouter.
Au cours de notre échange, je valide une suite de oui « yes set ». En accord avec C., je propose à la maman de rester pour la séance si elle le souhaite. Je recherche les centres d’intérêt, j’évoque un endroit sécure, un souvenir agréable, les vacances, le sport... C. choisit un circuit moto, car c’est une passion familiale. J’explique que je vais l’accompagner dans cet endroit, et lorsqu’elle s’y trouvera, elle me le fera savoir par un signe de tête ou de doigt (signaling).
Puis je lui demande de choisir un geste, croiser les doigts par exemple, afin de retrouver très facilement ce lieu et les sensations de bien-être, de confort pré-supposé. Je les invite toutes deux à s’installer le plus confortablement possible et je délivre toutes les autorisations, bouger, parler, ouvrir ou fermer les yeux... se sentir libre de faire ce qu’elles veulent. Entendre ou non les bruits qui nous entourent, écouter ma voix (inclusion)... J’obtiens une succession de « oui » qui me permet de valider le « yes set » avant de débuter la séance. Je m’assure qu’elles sont toutes deux confortablement installées. J’utilise une induction respiratoire pour favoriser l’induction d’anesthésie au masque.
Ayant travaillé la respiration avec la kinésithérapeute, C. se sent parfaitement à l’aise, je la félicite, elle sait parfaitement faire les choses... Simplement laisser l’air pénétrer par le nez ou par la bouche sans rien changer, puis en suivre le trajet sans effort, simplement... Approfondissement avec le body scanner : prêter attention aux points d’appui, différence entre la jambe droite... la jambe gauche... ressentir une lourdeur, une légèreté ou tout autre chose, position des bras (confusion). Un relâchement dans les mollets, les cuisses, les épaules, les bras, les muscles de la nuque, du visage, les muscles autour des yeux, avec des mouvements derrière l’écran des paupières fermées (C. a fermé les yeux), puis retour à la respiration pour se rendre compte comme la respiration est devenue encore plus calme, plus confortable, et comme le ventre accompagne la respiration tranquillement, calmement... Profiter de cette respiration pour souffler ce qui n’est plus utile, ce dont elle n’a plus besoin. Emprunter le chemin de son choix avec évocation du VAKOG et apercevoir une porte qu’elle imagine comme elle le souhaite... couleur... matériaux... taille décoration... Enfin, ouvrir cette porte pour entrer dans son endroit de sécurité. Je l’invite à s’installer encore plus confortablement... reprise du body scanner... appuis sur... moto (VAKOG)... les voix, les odeurs, les moteurs... se sentir calme, paisible, tranquille, profiter de ce moment... Je constate les signes de transe au niveau des muscles du visage, des mouvements oculaires, un relâchement des épaules (ratification et félicitations). Je m’assure que C. est bien dans cet endroit où elle se sent bien par un signaling, elle me fait oui de la tête, alors je lui demande de faire son geste (ancrage). Elle croise les doigts... Validation, félicitations.
- Suggestions post-hypnotiques (SPH) : elle retrouvera le confort de cet endroit, sans effort, simplement en faisant ce geste, en fermant les yeux et en laissant la respiration respirer comme elle respire... Elle peut utiliser ce geste chaque fois qu’elle en ressent le besoin, très simplement. Elle peut profiter de ce moment et garder cet état de détente pour les heures, les jours, les semaines qui viennent. Elle peut prendre ce qui est utile pour elle et laisser ce dont elle n’a plus besoin en sachant qu’elle peut toujours le retrouver si elle le souhaite, en laissant l’inconscient se souvenir de ce qui est nécessaire, afin que les choses se passent simplement comme elles doivent se passer. Apprécier le relâchement musculaire, le dos est très relâché, confortable, parfaitement détendu... Le corps sait très bien faire cela. Métaphore de la poupée de chiffon.
- Retour : lorsque tu auras assez profité, lorsque tu auras pris ce qui est utile pour toi et ce dont tu as besoin, tu peux reprendre le chemin, à ton rythme, et revenir dans cette pièce au centre de rééducation.
- Débriefing : sur le ressenti de la séance, si certaines choses ont dérangé, ou si elles souhaitent me faire part de quoi que ce soit. La maman me dit être bien détendue, mais ne pas avoir fait ce que j’ai suggéré. Je lui dis que c’est très bien et qu’elle a certainement fait ce qui était utile pour elle à ce moment précis. C. qui me sourit : « Ouah ! c’est ouf votre truc ! C’est trop bien, je ne voulais pas revenir ! » Je demande à C. si elle a réussi à aller dans son endroit. Elle confirme que oui. Je lui demande si elle a des questions ou des remarques sur cette expérience, s’il y a des choses qui l’ont gênée ou qu’elle souhaite faire différemment la prochaine fois. Je lui précise que c’est important de me le dire pour qu’on puisse être encore plus efficaces toutes les deux la séance prochaine. Elle me précise ne rien vouloir changer. Je vérifie que toutes deux sont d’accord pour bénéficier d’une seconde séance d’hypnose. Tout le monde est volontaire, alors je propose à C. de faire quelque chose qui va être très utile pour elle, pour la chirurgie et pour Emilie la chirurgienne qui va l’opérer.
- Prescription de tâches : je demande à C., jusqu’à notre prochaine rencontre, de réaliser chaque jour au moment de son choix, lorsqu’elle est confortablement installée, le geste qu’elle a choisi et laisser simplement revenir les sensations en fermant les yeux, en se concentrant sur sa respiration et en sentant la position de son corps comme on vient de le faire. Je compare l’autohypnose à la moto : « plus on en fait et plus ça devient simple ». Un rendez-vous est convenu avec C. et sa maman pour la semaine suivante. Je dis à C. que notre prochaine séance sera une révision de sa chirurgie, un peu comme on révise une leçon avant un examen et qu’on sait qu’on est parfaitement prêt et rassuré. « Tu es OK avec ça ? » Comme C. est d’accord, je lui propose…
Rachel Rey Infirmière anesthésiste en pédiatrie au CHU de Nancy depuis 2004. Accompagne les enfants avec l’hypnose en pré, per et post-opératoire. Intervenante à l’école d’IADE pour la prise en charge du nourrisson et de l’enfant. Diplôme universitaire des Techniques d’épuration extrarénale à Strasbourg. Formation hypnose médicale et hypnoanalgésie à l’IFH, hypnose et thérapies brèves à l’Institut UTHyL à Nancy.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°76 version Papier N°76 : Fév. / Mars / Avril 2025
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
. Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Livres en bouche
Illustrations de Caroline Berthet
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève
Catégories: Hypnose Ericksonienne Thérapie Brève

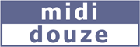



 Textes Fondateurs de l'Osteopathie / Champ Crânien. SUTHERLAND, LOUWETTE. Sully Paris
Textes Fondateurs de l'Osteopathie / Champ Crânien. SUTHERLAND, LOUWETTE. Sully Paris